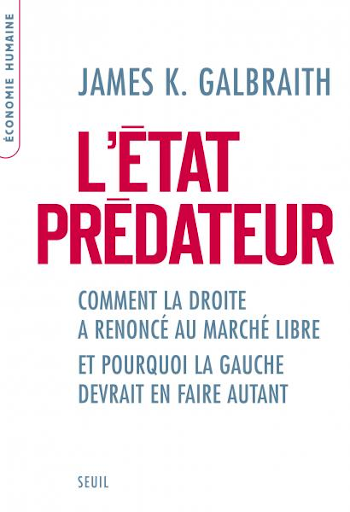À propos de l’ouvrage L’État prédateur: comment la droite a renoncé au marché libre et comment la gauche devrait en faire autant, de James K. Galbraith, éditions du Seuil, 2009, 312 pages.
Compte-rendu paru dans le supplément mensuel INDICES du journal L’Agefi en novembre 2009, p. 4.
L’auteur défend l’idée que l’État finit par se mettre au service d’intérêts privés et devient prédateur, cela que les gouvernements soient de droite ou de gauche.
Fils de l’économiste John K. Galbraith, auteur d’un ouvrage fameux intitulé Le nouvel État Industriel (1967), James K. Galbraith se situe comme son père dans la lignée des économistes américains de gauche, libéral dans la terminologie américaine, plutôt défenseur de l’État que du marché, autrement dit démocrate. Dans son ouvrage pourtant, James K. Galbraith critique l’État américain car, depuis le début du moment libéral il y a environ trente ans lorsque Reagan arrivait à la Présidence des États-Unis, jusqu’à la Présidence de Bush, en passant par celle de Clinton, cet État s’est révélé être prédateur.
État prédateur, avance l’auteur, c’est l’état où quelques uns, hommes politiques et hommes d’affaires appuyés par de puissants lobbies et mus par leurs propres intérêts, vont confisquer le pouvoir, sans goût particulier pour l’intérêt public. Sans idéologie non plus d’ailleurs. Par pur cupidité. Et si l’époque Reagan a inauguré ce mode ploutocrate, ses successeurs, démocrate comme républicain, n’ont pas été en reste… le point culminant étant été sans conteste atteint, selon l’auteur, lors des présidences de Bush fils (greed! pour reprendre un terme souvent lu, autrement dit: avide, cupide voire rapace).
L’ouvrage est construit en trois parties. La première discute le mythe du marché – ou, dit autrement, les diverses vérités de la doctrine conservatrice –, tandis que la deuxième précise les raisons et les façons de la prédation, laquelle revient à profiter de l’État en se servant du système à ses fins propres. La dernière partie est une invitation faite aux démocrates de se désintoxiquer, selon le propre mot de l’auteur, de l’idée de marché libre pour enfin affronter les problèmes qui se posent sans attendre.
Galbraith dresse un portrait peu flatteur des «conservateurs à principes», comme il les nomment, de l’ère Reagan qui, «après avoir occupé le devant de la scène, se sont vite retrouvés dans le désert politique, leur vraie place.» Et précisant sa pensée: «Ce sont des nobles sauvages et le désert est leur élément naturel. Ils ne sont pas faits pour être au gouvernement, parce que, sur un plan pratique, ils n’ont pas grand-chose à lui apporter; ils sont coupables de prendre trop au sérieux les mythes qu’ils ont aidés à créer…».
Toute charge déversée, Galbraith va démonter la logique de l’économie de l’offre dont l’idée première «est que les taux d’imposition affectent puissamment le comportement humain, qu’il existe un prix fiscal associé à l’épargne individuelle, et que réduire ce prix va produire un réflexe conditionné.» Il met en relief les contradictions inhérentes à cette théorie, comme il le fait des applications monétaristes, du mythe de l’équilibre budgétaire ou encore, de celui du soit disant libre-échange.
L’auteur va ensuite s’attacher à décrire l’oligarchie à l’œuvre au sommet de l’État. Ce que montre Galbraith, c’est la solidité des institutions mises en place à l’époque du New Deal et ce qu’il appelle le «pacte social américain» qui va résister au temps. Contrairement à la grande entreprise, autre socle présumé de la solidité économique du pays, qui va, elle, subir le basculement provoqué par les taux d’intérêt élevés des années 1980 et s’affaiblir considérablement. Et c’est précisément dans cet affranchissement de la grande entreprise que les membres d’une nouvelle caste économique portée par les banquiers d’affaires et les experts en technologies commencent à comprendre l’intérêt de s’approprier les avantages de l’État à leurs fins propres. «Les prédateurs aspirent les capacités de l’État, ils le vident de son aptitude à gouverner», affirme l’auteur.
Régler le problème de l’État prédateur est une course contre la montre, soutient Galbraith. Un problème parmi d’autres que doivent affronter les démocrates. Car, selon lui, les programmes des conservateurs qui mettent au centre des discours l’invocation à la magie du marché ne sont pas capables d’affronter les vrais problèmes du moment. Par exemple le risque écologique, l’offre d’énergie, l’effondrement des capacités des pouvoirs publics, aussi la corruption et la fraude dont la fraude électorale, ou la position périlleuse du dollar, la situation des immigrés, etc.
Pour ce faire, parmi les idées principales idées défendues: le retour de la planification. En bon keynésien, Galbraith place l’intervention publique pour inciter et encadrer les comportements des agents privés dans le domaine économique et social, de sorte à pallier les inégalités. La mise en place de normes et de salaires réglementés doit se substituer à l’État Prédateur.
Cet ouvrage critique est adressé aux dirigeants et conseillers démocrates. Or, les conseillers de l’actuel Président des États-Unis semblent être peu ou prou les mêmes que ceux de son prédécesseur démocrate – des années desquelles Galbraith se montre on l’a compris extrêmement critique –, la lecture de son ouvrage à l’écriture précise et toute en finesse, n’en est que plus savoureuse. Et le regard lucide de l’auteur sur la situation de son pays financé par d’autres vient clore avec gravité l’ouvrage, en guise de principe de réalité.