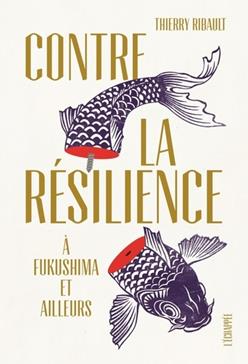À propos de l’ouvrage Contre la résilience à Fukushima et ailleurs de Thierry Ribault, éditions L’échappée, coll. Pour en finir avec, 368 pages, 38 francs ISBN 978-2-373-09086-4
Paru dans le supplément INDICES de L’Agefi, juin 2021.
La notion de résilience s’est imposée d’une façon tellement massive qu’elle mérite sans doute d’être interrogée ce que fait le chercheur en sciences sociales Thierry Ribault. Où «la résilience met en avant la perte, la chute comme moyen de rebondir, de se dépasser, mais ne serait-ce pas plutôt un moyen de nous tenir en laisse, de nous gouverner “par la peur de la peur”?» Où «la notion de résilience aidant, nous devrions être résistant sans opposer de résistance.»
—
La notion de résilience va de pair avec celle de résistance. En lien avec le bois entre autres matières ou matériaux, la résilience est un outil de résistance au changement. On l’évoque lorsque des matières ont été soumises à de conditions dures ou extrêmes, et retrouvent au final leur forme de départ. Faisons un détour par la gestion.
On se souvient des apports de la psycho-sociologie au milieu du siècle dernier et de ses applications au management en matière de changement et de résistance au changement. Notons que par la suite cette dernière notion a été sévèrement naturalisée. Or, passe encore de considérer que le tissu social puisse être soumis à de rudes conditions de changement et rester en forme, mais considérer que les êtres humains résistent naturellement, par peur du changement comme la vulgate managériale veut faire accroire…! Comme l’ont montré les sociologues des organisations, c’est souvent pour de bonnes raisons, c’est-à-dire rationnelles, que des individus ou des groupes ne souhaitent pas s’engager dans certains changements. On comprend cependant que naturaliser la notion de résistance est commode quand on veut de défausser de toute responsabilité!
Si la notion de résistance a paru suffisante dans le domaine de la gestion jusqu’il y a peu de temps en tout cas, au niveau psychologique celle de résilience s’est massivement imposée ces dernières décennies. Le psychiatre et psychanalyse Boris Cyrulnik l’a particulièrement popularisée. Dans le fond, chaque époque procure ses signifiants et l’on peut comprendre la notion de résilience à notre âge post-moderne comme une adaptation voire un retour de la théorie de la grâce du monde traditionnel d’autrefois. Glissons… et laissons la question de savoir si l’auteur d’«Un merveilleux malheur» qui avouait n’être pas un bon exemple de résilience, a été dépassé par le succès de ses écrits. Dans le fond, ce que Cyrulnik mettait en évidence, c’est le fait que certains sujets arrivaient à surmonter des catastrophes subies, tandis que d’autres pas, ce qui est en soi intéressant. Chez lui toutefois, la charge morale n’est pas essentielle, au contraire d’autres thuriféraires de la notion qui tracent une ligne de démarcation entre les gracieux – résilients (par nature?) – et les non-gracieux!
Cette entrée en matière permet de placer au cœur de notre sujet, les notions inextricablement liées de résistance et de résilience, mais aussi celles de responsabilité et de morale. Venons-en maintenant à la charge menée contre la notion de résilience par Thierry Ribault dans son ouvrage critique où il parle moins de gestion du changement, que d’administration du désastre, en référence à Jorge Semprun et Elie Wiesel. L’auteur a suivi très tôt et de très près la catastrophe de Fukushima, comme l’atteste l’ouvrage écrit en 2012 avec Nadine Ribault: «Les sanctuaires de l’abîme: Chronique du désastre de Fukushima».
On apprend que la résilience n’a pas été utilisé uniquement dans le domaine individuel et social, mais aussi écologique. Mentionnons les expériences dans les années 1950 pour mettre à l’épreuve des atolls du pacifique face à des assauts atomiques et mesurer leur capacité à se régénérer, mesurer leur résilience donc. De la sorte, il s’agit d’étudier les capacités du vivant à sa propre destruction, voire à ses capacités de tirer parti de sa destruction, en capitalisant sur d’éventuelles capacités émergentes que les chocs font naître. Construction d’une idéologie de la résistance à tout et en tout temps, nous fait comprendre Ribault.
«Contre la résilience à Fukushima et ailleurs» est composé de huit chapitres. L’auteur met d’emblée en scène la notion de résilience et ses thuriféraires. Il interroge le fait que «plus les causes des désastres sont connues avec précision, plus les réponses fournies se concentrent sur leurs conséquences, rendant ainsi mécaniquement les causes en question de plus en plus désastreuses». Car c’est là, ajoute-t-il, le principe de la résilience: «préparer les récepteurs au pire sans jamais en élucider les raisons.» Nous devrions ainsi être résistant sans opposer de résistance. Colossal! Ribault s’insurge tout autant contre le tissu d’absurdités «racialo-fatalisantes» – les japonais seraient particulièrement résilients(!?) –, que l’affirmation que les humains seraient par essence résilients et que, quelles que soient les situations, ils arriveront à toujours trouver quelque chose de positif. L’auteur fustige une véritable «soumission à intérioriser».
Selon lui, la résilience renvoie à une technologie sociale de l’ignorance, laquelle n’a rien à voir avec quelque secret ou mensonge, puisqu’il s’agit plutôt d’une «ignorance organisée» où un rétrécissement de la connaissance peut, seul, permettre l’adaptation. Ainsi, avec moins de connaissances, on s’en tirerait mieux qu’avec trop. Cet état où l’on se déleste de connaissances pour pouvoir s’adapter, conduit fatalement, selon lui, à vivre dans un monde faux. L’auteur défend avec force l’idée que la cogestion citoyenne des catastrophes – qu’il traite de long en large – est consubstantielle à cette falsification. Il montre qu’elle relève d’un mode de gouvernement par la peur de la peur, exhortant à faire du malheur un mérite. Avec la résilience, il n’y aurait, ajoute l’auteur, plus de solutions collectives, que du consentement individuel!
Ce concept, cette «imposture solutionniste», affirme Ribault, met en avant la perte, la chute comme moyen de rebondir, de se dépasser, mais, interroge-t-il, «ne serait-ce pas plutôt un moyen de nous tenir en laisse, ne donne-t-elle pas le moyen de nous gouverner “par la peur de la peur”? Ne serait-ce pas nous dire que “Oui, il y aura des catastrophes et nous ne pourrions rien y changer sauf à être résilient”?» À chacun.e d’appliquer éventuellement les analyses critiques contenues dans l’ouvrage à la pandémie actuelle.