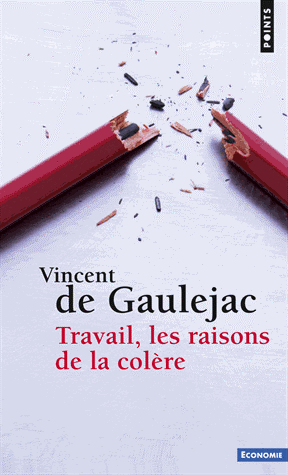À propos de l’ouvrage Travail: Les raisons de la colère, de Vincent de Gaulejac, éditions du Seuil, 2011, 324 pages
Interview paru dans le supplément mensuel INDICES du journal L’Agefi en mars 2011, p. 5
V. de Gaulejac en 5 dates:
1968: 29 avril, démission de chez un conseiller juridique; 1er mai, arrestation d’un ami; prise de conscience politique;
1979: parution de l’ouvrage L’emprise de l’organisation (Desclée de Brouwer);
1991: parution du Coût de l’excellence (Le) (Seuil);
2005: parution de La société malade de la gestion (Seuil);
2011: parution de Travail, les raisons de la colère (Seuil).
Perspective:
Les signes d’une crise profonde se multiplient dans les organisations et plus largement dans le monde du travail: stress, Bun Out, dépressions, suicides, perte de sens, précarité, pertes d’emplois, révoltes, manifestations, séquestrations, occupations… comme autant de manifestations destructives. Cependant, peut-on encore parler de crise lorsqu’elle devient permanente?, interroge V. de Gaulejac dont le récent ouvrage explore les sources de cette situation inquiétante. Rencontre avec l’auteur au cours de laquelle sont repriss ses premiers questionnements, ses premières hypothèses depuis son premier ouvrage.
Interview:
Pouvez-vous préciser ce qu’abordaient vos deux premiers ouvrages: L’emprise de l’organisation et Le coût de l’excellence?
Dans le premier, nous analysions l’émergence du nouveau modèle managérial à une époque de forte croissance dans une entreprise – il s’agissait d’IBM dont le management était proprement révolutionnaire. C’était la première fois que des chercheurs étaient confrontés en quelque sorte à une forme de pouvoir dans une phase d’expansion, d’exultation et de fascination car le «modèle managérial», on l’appellera ainsi, était au départ vécu comme un rêve permettant de réconcilier l’homme et l’entreprise. Effectivement, les travailleurs de l’entreprise analysée étaient heureux d’y travailler malgré la forte pression. Cependant, bien que ce modèle managérial se posait comme étant plus performant que le modèle disciplinaire taylorien-fordien précédent, nous commencions d’en faire la critique et ce, malgré le fait que les personnes y travaillant avaient objectivement intérêts à adhérer, pas seulement subjectivement.
Avec le deuxième ouvrage, nous analysions l’envers du décor de ce modèle dit dans les années 1980 de l’excellence – nous avons introduit le terme de «managinaire» –, car des problèmes se posaient en termes de coût en termes de santé que nous mettions en évidence; coût que les prometteurs de ce modèle ne voulaient bien sûr pas voir; or, il n’a fait que se renforcer depuis!
Quelles sont selon vous les sources du mal-être dans le monde du travail?
Un premier élément renvoie au déplacement du malaise et des symptômes du niveau somatique au niveau psychique, une partie de l’individu s’adaptant et s’identifiant aux exigences de l’entreprise et une autre partie y résistant. Cela explique d’ailleurs pourquoi le clivage est un des modes de défense face à ce pouvoir managérial nouveau. Le deuxième élément, à savoir la coupure dans les années 80’ du capitalisme de production et du capitalisme financier, a accéléré ce processus. Les taux de rentabilité démesurés exigés par les actionnaires ont eu pour conséquence une pression sur le travail qui a accéléré la révolution managériale, ses pratiques et ses outils: qualité totale, lean production, etc., toute une série de nouvelles pratiques managériales que l’on pourrait résumer par: «produire plus avec moins». Les technologies de l’information et de la communication constituent le troisième élément source du mal-être car elles ont donné une base technique apparemment neutre à ces nouvelles pratiques, à ces techniques d’objectivation qui ont laissé les travailleurs bien démunis.
On emploie depuis peu divers mots pour désigner le mal-être: violence, souffrance, risques psychosociaux (ou RPS)…
Christophe Dejours avait introduit il y a environ cinq ans le terme de violence. Puis a suivi souffrance et, depuis quelques temps, le terme de RPS s’est imposé, tout le monde semblant s’entendre sur son utilisation car il fait «neutre». L’idée à l’œuvre est que les Risques Psycho-Sociaux relèvent du dysfonctionnement et comme tel il peut être traité dans le cadre d’une analyse fonctionnaliste – avec des relents hygiénistes que l’on a pu croire dépassés.
Revenons sur cette révolution managériale que vous pointez: quel en est le déterminant?
Il est à la fois économique, politique et idéologique. Que l’on pense par exemple à la NPG (nouvelle gestion publique) à laquelle une partie de mon récent livre est consacré. On a affaire à un modèle que je qualifie de «globalitaire» en ce sens qu’il est censé s’appliquer à tous les contextes, qu’il est défendu par les institutions internationales, vendu par les Big 4 et enseigné dans les écoles de management… avec son lot de remise en question de la culture de gestion publique devenue obsolète, archaïque, bureaucratique, non performante, et avec, au contraire, une mise en exergue de la performance, du centrage sur le client, de l’obsession de la qualité, de ce que j’appelle la prescriptophrénie, soit des modèles de gestion prescriptifs et normatifs avec une obsession évaluatrice centrée sur les résultats et qui mettent nos instituions publiques en crise.
On vous a reproché parfois d’adopter une attitude dénonciatrice, pas assez constructives constructive or, dans votre dernier ouvrage, vous proposez des solutions: pouvez-vous y revenir?
Elles sont contenues dans le diagnostic. Politiquement d’abord, il convient de réguler le capitalisme financier en arrêtant de faire travailler l’argent sans connexion à des productions territorialisées. En d’autres termes, reconnecter le capitalisme de production et le capitalisme financier. Idéologiquement aussi, il est souhaitable de s’opposer à l’idéologie du NPM (new public management), du capital humain, des Ressources humaines qui font croire qu’elles se préoccupent de l’humain alors qu’elles le transforment en simple ressource au service du développement de l’entreprise.
Au niveau de l’entreprise encore et surtout, le management devrait s’employer à être à la hauteur de son rôle de production des négociations – en particulier en regard des contradictions que rencontrent les travailleurs de base pour bien travailler – et cesser de se préoccuper uniquement des résultats. En définitive, l’enjeu est de tenir compte à la fois du profit des actionnaires, des clients et des travailleurs en trouvant un équilibre entre ces trois forces. Enfin, il conviendrait de se préoccuper des contradictions qui peuvent exister entre la logique du profit et la préservation des ressources naturelles.
Sur tous ces registres, l’organisation taylorienne-fordiste fonctionnait sur un «gagnant-gagnant-gagnant», contrairement au modèle qui lui a succédé où l’actionnaire est le seul gagnant, d’où un déséquilibre entre l’économique, le social et le psychologique.