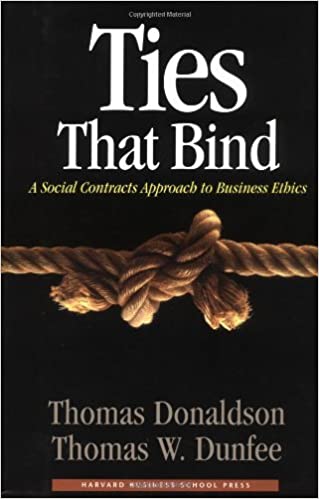Interview de Thomas Donaldson mené avec Ismaïl Diedhiou et Hugues Poltier, paru dans L’Agefi en 1999.
Perspective:
Professeur d’éthique des affaires à la Warton School de l’université de Pennsylvany, Tom Donaldson travaille depuis plusieurs années déjà à l’élaboration d’une théorie de la justice tenant compte des spécificités de la vie économique. En 1982 déjà, il publie Contract and Morality où il s’attache à déployer les termes implicites du contrat liant les entreprises à l’ensemble de la société. Il n’a cessé depuis d’approfondir ce thème de recherche qui occupe son dernier livre: Ties that Bind: A Social Contracts Approach to Business Ethics (avec T.W Dunfee; à paraître en 1999 chez Harvard Business Press).
Interview:
Pour quelles raisons un économiste devrait-il s’intéresser à la question morale?
Les sciences économiques sont intimement liées aux questions des valeurs humaines. La façon dont nous produisons ce dont nous avons besoin pour vivre, dont nous organisons notre vie professionnelle, dont nous faisons coexister vie professionnelle et vie privée, ainsi que la façon dont nous distribuons les fruits de la production économique, toutes ces questions sont à la fois d’ordre économique et moral.
Les sciences économiques sont nées à la fin du XVIIIè siècle en se présentant d’emblée comme une science morale. Depuis près d’un siècle, de nombreux économistes ont fait l’impasse sur ce caractère moral. Ils ont préféré réduire l’économie à une suite d’exercices mathématiques de nature prédictive ou interprétative. Fort heureusement, la seconde moitié de ce siècle a vu l’émergence d’interprétations économiques bien plus éclairées, je veux parler notamment des diverses incursions faites dans les domaines du développement, de la répartition des richesses ou encore des sciences politiques. C’est son travail à la frontière entre sciences économiques et éthique qui a rendu célèbre Amartya Sen, le dernier prix Nobel d’économie.
Pensez-vous véritablement que l’économie ait besoin d’un concept de Justice?
Sans concept de justice, l’économie est une science totalement usée. Une définition communément admise de la microéconomie la décrit comme «l’allocation rationnelle des ressources rares. Jusqu’ici tout va bien. Cependant, la situation idéale en microéconomie est appelée “l’Optimum de Pareto”. Schématiquement, “l’Optimum de Pareto” est une condition imposée par une situation de marché parfait et parfaitement libre. Par définition, c’est un état d’équilibre dans lequel aucun agent ne peut améliorer sa position sans qu’un autre agent voie sa position détériorée. Le problème, et de nombreux philosophes de l’économie pourraient vous le dire, c’est que les situations correspondant audit optimum peuvent être véritablement abominables. Il peut en effet très bien être compatible avec la situation suivante, par exemple: cent personnes vivent sur une île dont une personne détient la totalité des terres. Dans cet état d’”Optimum de Pareto”, une personne peut faire des nonante-neuf autres de véritables esclaves.
Même l’efficacité économique dépend fréquemment de valeurs. Ce fut un philosophe moral du XVIIème siècle qui le premier, exprima clairement cette idée. Il passa sept ans à enseigner la philosophie morale à l’Université de Glasgow, avant de se décider à écrire La Richesse des Nations.
Je vous laisse deviner son nom. Il s’agissait bien entendu d’Adam Smith. Comme Smith le nota, une économie ne peut prospérer que sur le socle d’un ensemble de valeurs morales communes. Smith vit très clairement que même ce système remarquable de libre entreprise, remarquable dans sa capacité à canaliser l’individualisme certes regrettable, mais également inévitable des hommes et à le diriger vers le bien commun, même ce système-là ne pouvait fonctionner efficacement sans l’accord de ses participants sur un minimum de valeurs morales communes.
Pour quelles raisons un manager (voire un professeur de management) devrait-il s’intéresser à la question morale?
J’ai déjà indiqué que les valeurs constituent comme une toile de fond nécessaire au bon fonctionnement de l’économie au sens large. Mais je dois ajouter qu’un effondrement des valeurs représente certes le meilleur moyen de ruiner une économie, mais que c’est également le meilleur moyen de ruiner une entreprise. Si chaque employé vit dans la crainte quotidienne du licenciement, si les règles sont largement perçues comme injustes et régulièrement ignorées, si l’on ne peut amener le personnel à répondre de ses actes que par le biais de procédures bureaucratiques, centralisées et dévoreuses de temps, alors oui, c’est toute l’entreprise qui est perdante. De nombreuses entreprises ont sacrifié l’éthique pour tenter d’accroître leur efficacité. Elles ont échoué et se sont retrouvées du fait même de cette politique, encore moins efficaces. C’est comme si elles tentaient de suivre le slogan du Pentagone aux États-Unis: “Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué!”.
Aux États-Unis, il y a une expression qui dit: “Faites en sorte que chaque dollar compte”. Cette expression a été interprétée par certains comme un acte de foi de pur mercantilisme. Elle a même trouvé une incarnation dans un certain type d’individus: ces personnes qui n’hésiteraient pas à faire inscrire sur leur pierre tombale le salaire moyen de leurs cinq dernières années de travail. Mais cette interprétation est fausse. En vérité, “Faites en sorte que chaque dollar compte”, c’est le symbole de la valeur vitale de l’efficacité économique, valeur promue par des individualités aussi éloignées l’une de l’autre que Milton Friedmann et Mohandas Gandhi. Je me souviens à ce propos d’un trait d’esprit de Peter Drucker, le célèbre théoricien du management américain. Il disait à peu près ceci: même si c’étaient des anges, et non pas des hommes d’affaires, qui siégeaient dans les conseils d’administration, ils devraient tout de même se soucier d’efficacité et de rentabilité. Sans l’efficacité et donc le surplus de capital que l’efficacité permet, la charité, qu’elle soit individuelle ou publique, deviendrait problématique, si ce n’est impossible. À vrai dire, j’estime que l’un des principaux enseignements que les écoles de management devraient transmettre aux futurs managers, c’est cette capacité à allouer de façon rationnelle et efficace les ressources. En quelques mots, il s’agirait de leur apprendre l’art de faire en sorte que chaque ressource économique (chaque dollar, chaque minute et chaque décision) compte.
Cependant, nous ne devrions pas nous soucier uniquement de valeur économique. Au contraire, nous devons promouvoir la pluralité des valeurs. Je soutiens que nous, hommes d’affaires et enseignants, devons-nous fixer pour objectif non seulement de faire en sorte que chaque dollar compte, mais également que chaque valeur compte. Faire en sorte que chaque valeur compte, cela veut dire rendre son importance à chaque valeur, qu’il s’agisse de la valeur de l’argent, de la valeur des différentes cultures, de la valeur de la préservation de l’environnement ou de la valeur de la dignité humaine.
Pensez-vous véritablement que le management ait besoin d’un concept de Justice? Comment articuler ces deux domaines?
Le management a clairement besoin d’un concept de justice. L’idée est de développer un concept de justice qui soit intimement intégré au monde des affaires lui-même; le piège en effet serait de créer un concept de justice absolu, totalement déconnecté des stratégies et des pressions spécifiques au monde des affaires, et ainsi de marginaliser le concept même de justice.
Deux grandes conceptions de la justice dans le monde des affaires ont émergé au cours des trente dernières années. La première s’intitule la Théorie de la Partie Prenante; la seconde, la Théorie du Contrat Social. La “Théorie de la Partie Prenante” (Stake Holders Theory) considère qu’une entreprise doit être comprise comme l’association de diverses “parties prenantes” (stake holders), c’est-à-dire des groupes qui sont partie prenante au bon fonctionnement de l’organisation, par exemple les employés, les actionnaires et les clients. En retour, les managers se doivent de satisfaire non seulement les intérêts d’une partie prenante, les actionnaires par exemple, mais également les intérêts des autres parties prenantes. Bien entendu, il se peut que dans certaines circonstances, certaines parties prenantes bénéficient de traitements privilégiés. Il en est ainsi par exemple des obligations envers les actionnaires, qui disposent dans la plupart des pays développés d’un statut défini par la loi. Néanmoins, les obligations morales des managers ne se réduisent pas à la satisfaction des intérêts financiers des actionnaires.
Venons-en maintenant à la seconde grande conception du concept de justice, “la Théorie du Contrat Social”. Cette théorie tente de donner sens aux accords implicites passés à l’intérieur et entre les différents groupes composant la société, par exemple entre les entreprises et les membres de la société. “La Théorie du Contrat Social” tente d’apporter des réponses à deux questions fondamentales: “Qu’est-ce que le monde des affaires peut raisonnablement attendre de la société?” et “Qu’est-ce qu’en retour la société devrait raisonnablement attendre des entreprises?”. Apporter des réponses à ces deux questions, c’est faire un pas considérable vers la compréhension du concept de justice dans le contexte particulier du monde des affaires. J’ai soutenu précédemment qu’au minimum, les entreprises devraient pouvoir disposer d’un statut spécifique dans le droit et pouvoir avoir accès aux ressources de la société, tant dans le domaine de la force de travail que dans celui des richesses naturelles. Pour sa part, la société devrait exiger des entreprises qu’elles adhèrent aux principes fondamentaux de justice et qu’elles veillent dans une certaine mesure aux intérêts des travailleurs et des consommateurs. Lorsqu’une entreprise rompt les termes de ce contrat social, elle perd le droit moral d’exister.
N’avez-vous pas l’impression que les intérêts des entreprises vont à l’encontre des canons de la justice?
La théorie des jeux et diverses autres formes d’analyses des interactions ont remis au goût du jour la pertinence des valeurs dans le monde des affaires. Il y a quelques années, j’ai été fasciné par un article traitant des marchés internationaux du caoutchouc et du riz (un article de Peter Kollock intitulé “The Emergency of Markets and Networks: An Experimental Study of Uncertainty, Commitment, and Trust.”). Je n’ai pas de passion particulière pour le caoutchouc ou le riz, mais j’ai tout de même lu cet article. Il démontrait que le marché du riz se comportait de la façon dont un certain nombre de modèles économiques le prédisait, c’est-à-dire d’une façon simple et individualiste. Des entreprises et des individus poursuivant leurs intérêts propres se confrontaient les uns aux autres et négociaient le partage des revenus. Le second marché, celui du caoutchouc, se comportait quant à lui de façon très différente. Pour en expliquer le fonctionnement, le seul moyen était de recourir à un ensemble de valeurs bien comprises, partagées par tous et qui avaient opéré sur ce marché durant des décennies. Comment expliquer la différence de fonctionnement entre ces deux marchés? L’auteur a avancé une explication liée selon lui à la nature des produits échangés. La qualité du riz est pour ainsi dire évidente; le riz, on le cuit, on le mange et on peut ainsi se rendre compte immédiatement de sa qualité. L’évaluation de la qualité du caoutchouc est quant à elle beaucoup plus difficile. Elle ne se révèle que longtemps après la transaction, elle n’apparaît même souvent qu’une fois le produit appliqué. Pour s’assurer d’un revenu confortable dans ces conditions, il faut pouvoir faire confiance à l’autre partie. Les implications pour les relations commerciales sont dès lors évidentes.
Lorsqu’un manager envisage la possibilité de s’engager dans une alliance stratégique avec une autre entreprise ou qu’il entame un processus d’effort commercial ou de développement de produits, nous sommes dans une situation qui répond davantage à la logique à l’œuvre sur le marché du caoutchouc qu’à celle qui opère sur le marché du riz. Les enjeux en effet sont élevés mais les gains que l’on peut en attendre ne peuvent se produire qu’à long terme. Les valeurs jouent souvent un rôle crucial dans le succès de telles relations.
Attardons-nous un peu sur les principes de Rawls. À votre avis, pour quelles raisons les entreprises devraient-elles endosser les deux principes rawlsiens, notamment celui de la différence?
Je ne suis pas certain que les entreprises aient véritablement besoin d’embrasser les deux principes de Rawls. Rawls conçoit ses principes comme des guides d’ordre général, traitant de la distribution au sein d’un schéma économique et social. Les entreprises sont bien plus importantes et bien plus riches que la plupart d’entre nous. En revanche, elles possèdent des personnalités extrêmement réduites. Je ne suis donc par sûr qu’elles aient besoin d’intégrer à leurs codes de bonne conduite ou à leurs déclarations de principes, l’ensemble des principes éthiques. Cependant, j’estime qu’elles devraient élaborer leurs propres principes, des principes adaptés à la vie des affaires et fondés sur la “Théorie de la Partie Prenante” ou sur la “Théorie du Contrat Social”.
Qu’entendez-vous par “Théorie des contrats sociaux intégrateurs”?
J’ai expliqué précédemment que de nombreuses personnes concevaient l’éthique des affaires sous l’angle du “contrat social”. Mon collègue Tom Dufee et moi-même avons récemment tenté d’intégrer deux types distincts de ce contrat social. Dans notre dernier ouvrage (Donaldson et Dufee, 1999), nous tentons d’intégrer je dirais le “macro-contrat”, celui qui impose les valeurs fondamentales et universelles, et les accords plus spécifiques, plus implicites également, qui fonctionnent au sein des différentes industries, au sein des économies nationales, des entreprises et de toute autre communauté économique. Ce faisant, nous allons à contre-courant des théories dominantes.
Nous affirmons que l’éthique des affaires ressemble davantage à un ensemble de conceptions communes, qu’à une série de déclarations définitives. C’est une mosaïque riche et parfois même incohérente. L’éthique des affaires, c’est davantage une histoire se faisant que les Dix Commandements. Nous pensons qu’elle peut et doit s’adapter aux évolutions technologiques, aux attitudes culturelles ou religieuses des communautés particulières qui l’adoptent.
Pourriez-vous nous donner deux ou trois exemples pratiques d’application de cette théorie?
Une fois encore, je dois répéter que la théorie rawlsienne est tellement générale que souvent elle ne peut rendre compte de telle ou telle situation spécifique du monde des affaires. Cependant, j’ai pu utiliser cette théorie dans le cadre d’une étude sur l’utilisation de conditionnalités dans l’octroi de prêts internationaux mis en place par des institutions comme la Banque Mondiale ou le FMI.
J’y ai défendu l’idée que lorsque que l’on pouvait prévoir que la mise en place de conditions pour l’octroi de prêts (comme par exemple le retrait des allocations sociales, la dévaluation de la monnaie ou la réduction de la dette de l’État) pouvait entraîner une dégradation de la situation de la frange la plus pauvre de la population, l’agence prêteuse avait l’obligation d’insister également sur la mise en place d’un “matelas social” destiné à protéger les plus pauvres (Donaldson, 1991).