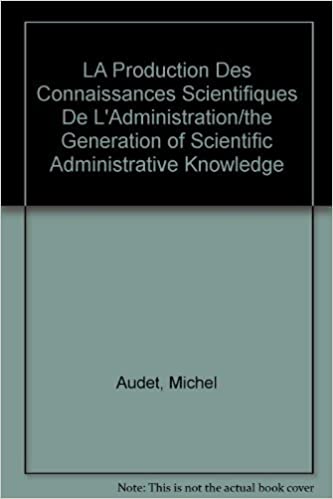Interview de Richard Déry paru dans le Bulletin des HEC Lausanne en 1996, dossier: “Du Management à la philosophie, en passant par l’économie”.
Perspective:
Richard Déry est professeur à l’École des HEC de l’Université de Montréal. L’objet principal de ses recherches est l’analyse de la construction des connaissances dans le domaine des sciences de la gestion. Il a d’abord, avec Michel Audet de l’Université du Québec, étudié l’évolution de la pensée épistémologique (philosophie des sciences) du XXè siècle. Outre cet angle théorique, ses travaux sont consacrés à des recherches empiriques: des analyses menées sur plusieurs années, à travers un thème précis, de tous les articles parus dans les revues managériales “scientifiques” américaines. Sa thèse de doctorat portait sur l’étude de tous les articles de la revue “American Science Quarterly” (pendant trente années) relatifs au thème de la décision. R. Déry est un inlassable lecteur. Il a continué depuis à entreprendre ce type d’analyse, à travers différents thèmes: stratégie, entrepreneurship, etc. Dans ces travaux, il met notamment en évidence l’éclatement des champs étudiés et les jeux disciplinaires qui y ont lieu. À côté de ces travaux lourds (plusieurs mio de Meg d’ordinateur utilisés), R. Déry entreprend des écrits pamphlétaires. Un livre devrait paraître en fin de cette année [Note : 1996].
Interview:
Vous avez commencé à vous intéresser aux théories de la gestion dans les années 70. Pouvez-vous préciser le contexte?
Dans les années 70, il était patent que le domaine de la théorie des organisations en général suscitait des critiques. La littérature, à travers les revues de management, faisait état de nombreux débats qui tournaient notamment autour des questions suivantes: la gestion est-elle avant tout une affaire d’art ou y était-il possible de prendre la gestion comme un objet d’étude scientifique? Faut-il effectuer des études de type qualitatif ou de type quantitatif? etc. Bref, des débats largement méthodologiques qui finalement renvoyaient à des enjeux épistémologiques.
Comment entendez-vous le terme “épistémologie”?
De mon point de vue, l'”épistémologie” a comme objet la constitution des connaissances scientifiques, constitution dans sa double acception: le savoir proprement constitué, et la genèse du savoir. Point de vue piagétien donc, avec la double idée d'”effectuer des connaissances” et d'”évaluer les connaissances” déjà constituées. Toute recherche qui prétend se questionner sur un savoir déjà constitué, ou qui se questionne sur la façon dont on constitue le savoir, relève du domaine de l’épistémologie.
Qu’entendez-vous par “méthodologie”?
J’entends les règles de recherche, les pratiques concrètes de recherche, c’est-à-dire la mise en relation entre un chercheur et son objet.
Merci pour ces précisions. Revenons sur les années 70.
Il y avait donc une série de débats qui méritaient pour être enrichis d’être posés en objets d’étude. Mon attitude a été la suivante: plutôt que de prendre position dans le débat, il m’a semblé qu’il valait mieux dans un premier temps l’étudier. Cela m’a rapidement amené à me rendre compte qu’au cœur de ces débats, il y avait des enjeux épistémologiques qui n’étaient que très rarement véritablement abordés. C’est alors que je me suis lancé dans un questionnement épistémologique à partir du constat de l’existence d’une certaine crise dans le champ disciplinaire des sciences de la gestion. Notez que c’est une attitude caractéristique de l’épistémologie au XXè siècle: les physiciens qui se sont mis à faire de l’épistémologie l’ont fait parce qu’ils avaient des problèmes concrets dans leurs disciplines; ils ont donc décidé de se questionner sur les fondements de leurs disciplines de manière à résoudre ces problèmes concrets. Le travail en épistémologie vient moins d’un goût pour les fondements que de la nécessité de résoudre des problèmes concrets.
Quels sont-ils ces problèmes concrets dans les théories de la gestion?
Ils sont légions, mais dans la mesure où on prétendait pouvoir subordonner la pratique à sa théorisation – puisque c’était largement ce qui dominait dans les années 70 –, encore fallait-il encore se demander de quelle nature était le savoir que l’on entendait imposer à la pratique. Et puisque ce savoir était largement inutilisé, ou porteur d’effets pervers, il devenait non seulement pertinent mais également urgent de le questionner.
Pouvez-vous prendre l’exemple d’un débat caractéristique de cette époque?
Le plus beau débat qui a animé et dominé les années 70 et une partie des années 80, était sans contredit celui qui opposait les tenants d’approches qualitatives aux tenants d’approches quantitatives. De nombreux numéros spéciaux de revues “scientifiques” de management gravitaient autour de ces deux voies de recherches, qualitatives d’une part et quantitatives d’autre part.
Une manière de revenir à la vieille question: explication ou compréhension?
Oui, c’était l’idée de savoir s’il est possible de construire une science de la gestion à l’image des sciences de la nature, ou si est plus avantageux de construire une science de la gestion à l’image des sciences sociales. Et dans ce second cas, doit-on continuer à s’enfoncer dans un empirisme abstrait, ou doit-on plutôt appliquer des méthodes phénoménologiques favorisant la recherche de sens?
Ce qu’il y avait d’intéressant, c’est que ces débats étaient toujours situés sur un plan méthodologique: on opposait le chiffre au mot, la quantification à la signification, etc., et au fond on se disait que ces deux méthodes n’étaient peut-être pas incompatibles. Mais pas d’études épistémologiques proprement dites.
C’est donc dans ce contexte que vous aviez commencé votre travail de recherche au début des années 80?
Tout à fait. Tous ces débats-là renvoyaient clairement à des discussions épistémologiques sur la constitution du savoir en gestion: qu’est-ce que cette chose particulière que l’on appelle le savoir en sciences de la gestion? et qu’est-ce que cette prétention qu’ont certains à qualifier leur domaine de “sciences de la gestion”? Avec toute l’ambiguïté que ça implique.
L’idée d’une science de la gestion ne signifie absolument pas: gérer scientifiquement, mais plutôt, par exemple: faire à la manière des sociologues qui étudient des pratiques sociales. Quand ceux-ci étudient des pratiques sociales, ils ne prétendent pas que l’acteur social agit scientifiquement, mais posent la pratique de cet acteur comme objet d’étude et tentent d’élucider le procès de la vie quotidienne. Ainsi, de la même façon, poser la gestion comme objet d’étude, et prétendre le faire de manière cohérente, c’est faire oeuvre de sciences de la gestion.
En quoi consistait votre travail de thèse?
Il avait entre autres comme objectif de poser tous ces débats comme objets d’étude. Or, à partir du moment où l’on étudie une série de débats de nature méthodologique, théoriques, de débats sur le statut des sciences de la gestion, etc., et où l’on désire questionner leur bien-fondé, on est nécessairement conduit dans le territoire de l’épistémologie. Il est d’ailleurs intéressant de noter qu’à l’époque, les chercheurs en sciences de la gestion importaient des éléments du débat du champ épistémologique en général, sans toutefois établir clairement les liens avec leurs propres positions!
Avec Michel Audet qui a été probablement l’un des premiers à se questionner sur l’épistémologie des sciences de la gestion, vous avez entrepris de comprendre l’évolution de la pensée en épistémologie au cours de ce siècle, en guise de prolégomènes. Quel travail avez-vous effectué ensemble?
Nous avons étudié l’évolution de l’épistémologie au XXè siècle, épistémologie entendue comme l’étude de la constitution des connaissances scientifiques au sens large et non pas réduit à la seule philosophie des sciences. On a découpé l’évolution de l’épistémologie au XXè siècle en quatre moments historiques clés, correspondant à quatre façons de se représenter cette constitution des connaissances scientifiques. Le premier moment, c’est ce qu’on a appelé le procès formel. Il consiste à voir dans la science un processus formel de constitution des connaissances scientifiques. On trouve sous cette étiquette les penseurs du Cercle de Vienne (positivisme logique), le rationalisme critique (largement représenté par Karl Popper), et toute une série de travaux qui accréditaient l’idée qu’il était possible de constituer des connaissances vraies (notamment les travaux de Robert Merton).
Deuxième moment, en opposition à cette représentation formelle et rationnelle de la science, il y a ce que l’on a appelé le procès historique. Dans ce procès historique, on peut distinguer deux moments principaux: une psycho-historique des connaissances et une sociogenèse des connaissances. La psychogénèse nous est largement donnée par Piaget qui nous dit: les connaissances ne se présentent pas construites d’avance en attente d’être jugées vraies ou fausses, elles sont le fait d’une construction par un sujet connaissant qui interagit avec un objet à connaître. Mieux encore: la clé de voûte de la construction des connaissances se trouvent dans l’action qui est en quelque sorte au principe de la constitution des connaissances. À l’échelle d’un champ scientifique, cela signifie que la méthodologie n’est rien d’autre qu’un système coordonné d’actions… C’est là un enjeu central, parce que si l’action est ce qui est porteur et créateur de connaissance, engager le débat sur les actions c’est ultimement engager le débat sur le genre de connaissances qu’on va avoir à terme, puisque, suivant Piaget: les connaissances sont construites par des sujets connaissants. Le deuxième courant, la socio-genèse, largement représenté par Thomas Khun nous dit en quelque sorte: les connaissances sont construites, et cela, historiquement – elles changent dans le temps et ne procèdent pas nécessairement par accumulation de connaissances vraies –, et sociologiquement – avec l’idée des communautés scientifiques. Avec ce deuxième moment, on commençait à ébranler très sérieusement l’image en quelque sorte hagiographique, orthodoxe, qu’on pouvait avoir de la science comme accumulation de connaissances.
Dans la foulée des travaux de Kuhn, le troisième moment est ce qu’on a appelé le procès social pour les tenants duquel la science est un artefact socialement construit. Ce moment est représenté par les représentants de l’école d’Edimbourg, avec notamment Barnes et Bloor. Ces derniers partent du constat que ce qui domine dans l’explication du succès scientifique, c’est la logique, tandis que l’échec est expliqué lui par des facteurs sociologiques. À l’échelle des disciplines scientifiques, on expliquait la force des sciences de la nature par des facteurs logiques, et la supposée faiblesse des sciences sociales par des facteurs sociologiques. La position de Barnes et Bloor était en quelque sorte de dire: il n’y a aucune raison de continuer de construire des argumentations asymétriques, appliquons donc à la science une symétrie d’explication en tentant d’expliquer l’échec et le succès scientifiques autant par des facteurs logiques que par des facteurs sociologiques. C’est en quelque sorte une espèce de réconciliation et un durcissement du “procès formel” et du “procès historique” (à la Khun). En mobilisant les deux systèmes d’explication, Barnes et Bloor mettent à l’agenda l’importance d’un questionnement du caractère social de la science. Ici donc, on ne tient plus le progrès de la science pour acquis, mais on essaie de montrer que la connaissance scientifique est un objet social comme un autre. C’est dans ce troisième moment que s’inscrivent les travaux célèbres de Latour et Woolgar dans les laboratoires où les auteurs montrent que finalement les connaissances sont socialement construites, et que donc les outils servant à étudier les phénomènes sont des outils sociaux. Et, qu’ultimement, le moyen pour rendre compte de la science est précisément un discours construit pour susciter l’adhésion.
On arrive au dernier moment, le procès discursif où on met de l’avant une représentation discursive de la science: la science est peut-être un processus historique, social, voire même logique, mais elle est aussi un processus discursif. Elle se matérialise dans un discours qui vise à convaincre. L’enjeu ici renvoie donc moins à la notion de vérité qui, cruciale dans le “procès formel”, qu’à celle d’autorité. La science apparait davantage politique que logique. L’étude des textes scientifiques tend à accréditer cette idée, car lorsqu’on lit un texte scientifique, ce qu’on trouve, c’est une pléiade de références, des renvois en bas de page, des subventions obtenues, des remerciements, etc.
C’est donc après ce travail d’éclaircissement que vous avez vous-même pris position.
J’ai en effet développé une option épistémologie largement piagétienne où je considère la science comme un processus de construction entre un sujet connaissant et un objet, mais également entre un sujet connaissant et un champ scientifique. Autrement dit, la construction de connaissances ne se fait pas uniquement entre un sujet et un objet, mais également entre un sujet et un champ. Elle appartient à un champ où on cherche à prendre position, à prendre option, comme dirait Pierre Bourdieu. Partant de là, j’ai appliqué cette logique aux sciences de la gestion, en m’intéressant à un débat particulier où foisonnait une incroyable diversité d’options théoriques: celui entourant les théories de la décision. J’ai alors décidé de retenir la revue américaine Administrative Science Quarterly qui était la plus vieille revue de théories des organisations, considérée dans le champ américain comme la plus prestigieuse et également comme la plus orthodoxe. J’ai ainsi analysé les articles parus dans ASQ, du premier numéro en 1956, jusqu’en 1985, et de faire une analyse empirique sur ces textes.
Que montrait votre thèse?
Ce que j’ai tenté de montrer, c’est que la construction de la problématique de la décision telle qu’elle se donne à l’entendement dans cette revue, est une triple construction. Premièrement, une construction objectale: l’objet décision est construit dans le temps, c’est-à-dire qu’on ajoute des facettes, des niveaux d’analyses, on multiplie l’univers concret – tantôt la décision dans la petite entreprise, tantôt dans la grande, dans secteur public, dans le para-public, etc. Deuxièmement, une structuration sociale: on assiste, dans la construction de la problématique de la décision, à un débat disciplinaire qui a été le point de rencontre de sociologues, de psychologues, de politicologues, de cognitivistes, de gens plutôt formés en sciences de la gestion, etc., tous se disputant la théorisation de la décision. Troisièmement, une construction argumentative.
Je mettais également en évidence, de manière empirique, que le champ des sciences de la gestion est un champ incroyablement fragmenté. Par exemple, je suis arrivé à constater que dans les bibliographies des articles publiées dans ASQ, au-delà de 85% des bibliographies de chacun des textes, contenait des titres qui n’avaient jamais été utilisés par les auteurs précédents la publication de l’article, et ne seraient jamais repris par les auteurs qui suivraient! D’un certain point de vue, chaque article du point de vue de ses références est largement singulier, chacun arrivant dans le débat avec son propre cadre théorique et ses propres références. Et plus j’étudiais les références et les méthodes, plus il apparaissait qu’on était dans un champ très fragmenté. C’est là une caractéristique majeure des sciences de la gestion.