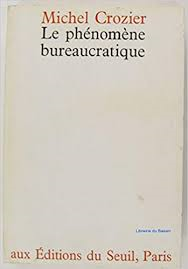Interview de Michel Crozier (1ère partie) paru dans le Journal de Genève et Gazette de Lausanne, supplément hebdomadaire “Le Jeudi économique”, 1994.
Perspective:
Fondateur de l’école française de “sociologie des organisations”, Michel Crozier a proposé une méthode d’analyse connue sous le nom d’analyse stratégique. Dès le début des années soixante, il s’est démarqué à la fois d’une sociologie marxiste jugée trop déterministe et d’une approche managériale étroitement rationaliste, en imposant un style d’analyse pragmatique. Le thème central de ce “classique” de la théorie des organisations – dont l’oeuvre est connue aussi bien en Europe qu’en Amérique du nord est le changement. Il a notamment fait passer l’idée que l’écoute est une qualité essentielle dans le management des entreprises. Après avoir présenté les concepts de base de sa méthode d’analyse, ce chercheur et homme de terrain relate certaines de ses expériences concrètes.
Après l’obtention d’un diplôme commercial (1943), Michel Crozier consolide sa formation par des études supérieures d’économie et d’administration, ainsi que par des études de Lettres. En 1947, il obtient une bourse pour mener une recherche sur les syndicats américains. Il découvre alors les États-Unis où il écrit d’ailleurs – en langue anglaise – la première version de son fameux ouvrage Le phénomène bureaucratique (1963). Cette dernière étude s’est très vite imposée, et fait aujourd’hui partie des ouvrages classiques de la théorie des organisations. Un autre livre s’en suivra, L’acteur et le système (1977), dans lequel, avec Erhard Friedberg, il formalise sa méthode d’analyse sociologique.
Auteur de nombreux autres ouvrages, Michel Crozier s’attache principalement à comprendre les blocages de la société française, à présenter des diagnostics et à proposer des solutions. Mentionnons: La société bloquée (Seuil, 1970); On ne change pas la société par décret (Seuil, 1979); État moderne, État modeste (Seuil, 1987); L’entreprise à l’écoute (InterÉditions, 1989); La crise de l’intelligence: essai sur l’impuissance des élites à se transformer (InterÉditions, 1995). Aidé d’une bonne connaissance des États-Unis – il y a enseigné dans les Universités les plus prestigieuses –, il a même rédigé un ouvrage sur ce pays: Le mal américain (Fayard, 1980).
Interview:
Votre sociologie est connue sous le nom d'”analyse stratégique”, que faut-il entendre par là?
Dans “analyse stratégique”, il y a deux termes. Il y a d’abord “analyse”, qu’il convient d’opposer à “théorie”. Cette première opposition signifie que nous mettons l’accent sur la description des situations que nous analysons, c’est-à-dire que notre point de vue n’est pas prescriptif. Il y a ensuite “stratégique”, terme qui est à opposer à planification, et qui permet de dépasser le “déterminisme”. Cette seconde opposition signifie que pour nous les comportements sont orientés, qu’ils sont intentionnels, l’intérêt consistant en l’occurrence à savoir à quoi ils aboutissent.
J’admets que le terme “stratégie” n’est sans doute pas heureux puisqu’il évoque la guerre, mais nous n’en avons pas trouvé de meilleur. Si l’on s’en tient toutefois à la définition suivante de la stratégie: “l’art des rapports de force” –en interprétant “force” le plus largement possible, c’est-à-dire en incluant le jeu des influences –, alors ce terme me semble tout à fait acceptable. Le stratège a un ennemi – contrairement au planificateur qui se contente de dérouler toutes ses opérations –, aussi doit-il donc compter avec l'”incertitude” relative au comportement de l’ennemi ou du partenaire. Si nous voulons “analyser stratégique”, c’est parce que nous voulons comprendre les comportements comme ayant une intentionnalité, mais aussi comme étant variables: l’intentionnalité existe toujours mais la direction est variable en fonction du contexte ami-ennemi.
Vous inspirez-vous de la théorie des jeux?
D’une certaine manière oui, quoique nous essayons cependant de la dépasser parce que nous ne sommes pas dans le jeu rationnel des économistes, mais dans le système social qui est complexe. En fait, notre propos consiste à créer une matrice, et non pas à la résoudre.
C’est cette matrice que vous appelez le “système d’action concret”?
Tout à fait.
Parmi les notions importantes de votre approche, il y a celles d’acteur et de pouvoir. Pourriez-vous les expliciter?
Bien sûr. Le dépassement de la théorie des jeux que j’évoquais, signifie que l’on s’efforce d’abord de cerner ce qui est important; on est stimulé par la théorie des jeux mais on ne la refait pas. L’essentiel réside dans la définition du jeu, et, de plus on n’est pas stratège comme un guerrier. Un guerrier a ou choisit un ennemi et il a une vision destructrice: gagner signifie détruire l’ennemi. Les êtres humains dans les organisations et les systèmes vivent avec l’ennemi, et donc le problème n’est pas la destruction mais plutôt un développement favorable. Si vous voulez, il doit chercher normalement à ne pas avoir un jeu à somme nulle, parce que dans un cas il s’appauvrit lui-même, ou du moins il se bloque.
Relativement à l’acteur et au pouvoir, je résume brièvement en disant qu’on analyse les situations concrètes en termes de stratégie-jeu et de pouvoir-incertitude. L’acteur est l’élément-clé de notre analyse. À cet égard, je précise que je souscris à l’idée qu’on ne peut connaître la réalité qu’à partir des gens qui la vivent, qui peuvent en parler et dont on peut comprendre le comportement. Il n’y a donc pour moi que des individus qui peuvent être acteurs. Ils sont certes influencés par leur appartenance à des groupes, mais des groupes ne sont pas des acteurs. (Ndlr: cette position qui n’accordent d’existence qu’à des individus et non à des groupes est connu sous le nom d'”individualisme méthodologique”.) Pour comprendre le comportement de l’acteur, nous avons recours au raisonnement stratégie-jeu, c’est-à-dire qu’un acteur a un comportement stratégique qu’on va comprendre à partir des jeux de relations dans lesquelles il est impliqué. Cela nous permet notamment de comprendre en quoi sa stratégie est rationnelle. Et pour comprendre cela, il faut que l’on comprenne le jeu dans lequel il est engagé. Un comportement complètement irrationnel vu de Sirius, apparait comme rationnel en fonction du contexte, des partenaires, etc… L’autre couple de concepts, pour nous, c’est le pouvoir-incertitude. Pour comprendre pourquoi les gens agissent dans un univers de contraintes, et bien il faut voir le comment de leur action, et c’est à travers l’utilisation du pouvoir qu’ils agissent. On ne peut pas agir sans pouvoir. Je définis le pouvoir en terme “relationnel”: on n’a pas de pouvoir hors de relations avec autrui, et ce que l’on appelle pouvoir, c’est une relation dans laquelle les “termes de l’échange” vous sont favorables. Il y a donc toujours de la réciprocité dans le pouvoir. Vous ne pouvez pas avoir du pouvoir sur quelqu’un sans que ce quelqu’un puisse avoir du pouvoir sur vous. Pouvoir-incertitude, çà signifie que dans un ensemble organisé, on a du pouvoir parce que l’on maîtrise une zone d’incertitude. Si vous êtes la personne qui contrôlez une telle zone, et bien vous aurez du pouvoir sur ceux qui sont affectés par l’incertitude que vous contrôlez. Mais, comme il y a rarement situation de monopole, chacun essaie d’influencer en fonction des incertitudes qu’il contrôle, d’où la complexité des points de vue des actes et des contradictions en ce qui concerne la rationalisation. Tout le monde voudrait en effet que les autres soient rationalisés, mais à condition de rester soi-même libre!
Il en est donc de la notion de pouvoir comme il en est de celle de rationalité, c’est-à-dire que vous n’en prenez pas la signification substantive, n’est-ce pas?
C’est ça. Parce que nous étudions des situations dans des systèmes organisés, nous concevons le pouvoir en terme de relation et non de domination… un peu de la même façon que nous n’empruntons pas l’idée de rationalité traditionnelle des économistes, mais celui proposé par Simon, c’est-à-dire la “rationalité limitée”.
Avec votre livre La société bloquée (1970), vous portez votre attention sur la France et ses blocages. Considérez-vous un pays comme une organisation?
Non. En fait, dès mon premier livre important, Le phénomène bureaucratique (1963), je m’intéresse à des organisations, et pour les comprendre j’étudie le poids que l’État a sur elles. Il s’agit d’organisations administratives françaises concrètes, et j’essaie dans la troisième partie du livre de voir ce qu’il y a au-dessus. C’est alors que je découvre le système administratif français, et que je remarque des régularités malgré des différences très grandes et des oppositions. On retrouve des mécanismes relativement semblables. Ma perspective est celle du changement. Aussi, La société bloquée est une réflexion sur le changement dans la société française, et sur la nécessité de dépasser les blocages de cette société.
Après ce livre, j’ai rédigé d’autres ouvrages, notamment: On ne change pas la société par décret (1979) et État moderne, État modeste (1987), sans oublier L’entreprise à l’écoute (1989), ce dernier se situant dans la même ligne de pensée et d’analyse que les précédents, à ceci près qu’il porte sur le management privé. Sinon, il s’agit bien de la même inspiration et de la même démarche.
Pouvez-vous expliquer le changement de perspective entre La société bloquée et État moderne, État modeste?
Oui. J’avais décrit, dans le premier des deux ouvrages, la société française comme façonnée par son État, celui-ci ayant été un moteur particulièrement fort. Dans État moderne État modeste, je montre davantage la discordance entre la société et l’État, et ce que je dis c’est que l’on avait un État retardataire essayant de moderniser une société plus moderne que lui. Voilà. Dans La société bloquée, je disais qu’il fallait changer l’État pour que la société change. Je n’étais pas complètement libéré de l’idée que c’est l’État qui change la société. Dans État modeste, je suis beaucoup plus catégorique: la société change, elle se modernise et l’État doit être à son service. Alors, cela dit, dans la réflexion que je poursuis présentement – je renvoie à mon dernier livre, La crise de l’intelligence… (InterÉditions, 1995) –, sans revenir à la première position, je crois qu’il est tout à fait indispensable de changer l’État pour libérer davantage la société d’une emprise paralysante.
Prenons un exemple pratique de changement: la décentralisation. La façon dont elle a été faite en France, vous semblez ne pas l’approuver…
C’est exact. Pour la décentralisation, l’orientation prise a découlé à mon avis d’un mauvais diagnostic. Le diagnostic reposait sur le raisonnement suivant: l’État central – le gouvernement – veut accaparer le pouvoir et conséquemment nous avons cette centralisation par soif de pouvoir du centre; alors, redistribuons le pouvoir grâce à un changement de structure, pour donner du pouvoir au périphérique. Mon point de vue était très différent. Je disais quant à moi que la soif de pouvoir au centre existait comme partout, que le centre était tout à fait impuissant, que la pression pour la centralisation venait tout autant de la périphérie que du centre. Je pensais donc que si on voulait réellement changer il fallait changer le système, et que les réformes de structure peuvent changer les positions des gens mais ils ne changeront pas les caractéristiques du système et ses défauts fondamentaux qui sont la confusion, l’irresponsabilité, conséquence du cloisonnement de la mauvaise communication et du “système D” indispensable pour le faire marcher… Alors, je prédisais que la décentralisation ne donnerait pas du tout le résultat qu’on attendait; je crois malheureusement avoir eu raison.
Qu’auriez-vous préconisé comme changement dans ce cas?
Cela nous entraîne dans une discussion complexe que je ne peux pas résumer. Je peux cependant vous donner le point final: un changement le plus limité possible qui aurait fait de la région l’organe essentiel de la décentralisation. Je préconisais d’effectuer une réforme volontairement simpliste qui était l’élection d’une assemblée régionale au suffrage universel direct, et de mettre l’accent sur la constitution de la région comme entité politique – et non pas comme niveau structurel interne à l’administration. La vision qui était la mienne c’était que pour réussir à passer il faut faire quelque chose de très simple. Et donc suffrage universel direct et avec un scrutin territorial, pas proportionnel – la proportionnelle aurait été à mon sens plus intéressante au niveau du département. Quand il faut décider quelque chose, mieux vaut disposer d’une majorité. Le département qui administre plutôt qu’il ne décide politiquement, aurait été un organe de gestion dans lequel tout le monde aurait appris à coopérer. Mais l’organe de décision et d’orientation, la région, devait avoir une majorité. Ce que j’aurais aimé, c’est un exécutif “à la suisse” – ça marche très bien sept personnages. Un collège exécutif me semble tout à fait intéressant.
Pourquoi n’a-t-on pas changé dans ce sens-là?
Parce que le diagnostic était mauvais. La concentration française restait la même.
Lors d’un conflit à la SNCF, vous avez été appelé – avec Jacques Lesourne – à effectuer une analyse. En quoi a consisté votre travail?
D’abord, en un diagnostic: en écoutant réellement les gens et en ne les écoutant pas dans leurs plaintes et dans leurs demandes, mais en les écoutant dans leurs “jeux stratégiques”. Cela veut dire simplement qu’on fait parler les gens sur leur situation, sur leurs problèmes, les uns avec les autres, avec la hiérarchie, avec les subordonnés quand les gens ont des subordonnés, etc. On a donc les points de vue des uns et des autres, et à partir de ces points de vue, on dispose d’une première image des relations. Ce diagnostic, on le restitue aux intéressés, c’est-à-dire qu’on leur présente nos résultats qu’ils discutent et authentifient. À partir de là, on enclenche un processus de changement. Dans le cas de la SNCF, on a rendu compte à tous les groupes dont on a interviewé les membres, et tous ont confirmé la validité de notre diagnostic. À partir de là, nous avons fait accepter à la direction générale l’idée de rendre publics ces résultats, ce qui a été fait: d’abord dans une journée de présentation des résultats devant tous les cadres supérieurs moyens et subalternes; ensuite, cette présentation a été faite à la direction générale; et enfin, le lendemain, aux syndicats. À partir de ce premier travail qui a duré six mois, nous avons aidé à l’interprétation. Des changements considérables ont été accomplis.
Nous procédons de la même manière à Air France actuellement. Nous avons fait une première partie plus rapidement qu’à la SNCF parce que le temps pressait, trois mois. Nous avons écouté une centaine de personnes en profondeur, après quoi nous avons procédé aux restitutions et établi un questionnaire à l’ensemble du personnel. Finalement, cela a changé les données du jeu. Le PDG Christian Blanc a négocié et un référendum s’en est suivi afin d’approuver les plans de restructuration. Après cela, une équipe formée de personnes de la SMG a fait le travail de guidage de la réforme. Comme vous le voyez, on ne se contente pas de dire en général ce qu’il faut faire…
La notion d’apprentissage collectif revient souvent dans vos écrits, de même que celle d’expérimentation.
L’apprentissage collectif est une notion que j’ai développée à partir des notions de “jeu” et de “système”. Elle est basée sur un double constat: les gens ont des comportements donnés parce qu’ils sont pris dans des jeux qui constituent système et parce que personne ne souhaite perdre. Dès lors, si vous voulez changer, il faut changer le jeu et non les personnes, changer le jeu voulant dire qu’il faut que l’on apprenne à jouer autrement. Et comme personne n’a envie de jouer autrement tout seul, car ainsi il serait sûr de perdre, ça veut dire que c’est un apprentissage collectif.
Alors, ce qu’on peut dire de l’expérimentation, c’est qu’elle va permettre, si elle réussit, un apprentissage collectif. Pour être concret, prenons le cas de jeux dominants dans les situations bureaucratiques, c’est-à-dire des jeux de protection et d’opacité. Pour pouvoir se maintenir dans le jeu bureaucratique, on va s’efforcer d’être opaque afin de se protéger. Ainsi, si vous voulez avoir une situation moins hiérarchique, moins cloisonnée, il faut absolument que les gens apprennent à jouer plus de façon plus ouverte. Donc l’expérimentation doit avoir comme objectif de rendre possible que les gens apprennent à jouer ce cette façon-là.
Pratiquement, quel a été l’expérimentation dans le cas SNCF?
Et bien, à la SNCF, on a d’abord supprimé les deux échelons-clés de la hiérarchie, ce qui a transformé la nature du jeu entre le chef d’établissement devenu plus responsable et son personnel. Ensuite, on a supprimé le rapport entre les conducteurs et les deux maîtrises concurrentes qui s’occupaient d’eux. On s’est efforcé en fait de créer un climat de communication plus ouvert, lequel a été rapidement efficace. En plus des changements structurels, il y a aussi un aspect de formation des personnes, de soutien et de mesure pratique prise par le responsable, pénétré du caractère essentiel de l’écoute. On a aussi créé un climat de relations tel que quand il y a un incident les conducteurs sont incités à coopérer en donnant leur version des événements, leurs suggestions et leurs critiques. Ceci est apparu comme une novation extraordinaire, parce qu’ils avaient appris à parler face à leurs supérieurs sans craintes que leurs paroles ne soient exploitées contre eux.