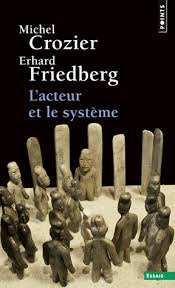Interview d’Erhard Friedberg (1ère partie) paru dans le Journal de Genève et Gazette de Lausanne, supplément hebdomadaire “Le Jeudi économique”, 1994.
Perspective:
Directeur du CSO (Centre de sociologie des organisations) et responsable du DEA de sociologie à l’I.E.P (Institut d’études politiques) de Paris, Erhard Friedberg a contribué à asseoir les bases théoriques de la tradition de l'”école française de la sociologie des organisations” initiée par Michel Crozier.
La célèbre étude de ce dernier, Le phénomène bureaucratique (Seuil, 1964), est considérée des deux côtés de l’Atlantique comme un classique des études organisationnelles. À partir d’elle et de nombreuses autres recherches empiriques effectuées par les chercheurs du CSO, Michel Crozier et Erhard Friedberg ont formalisé leur approche d’analyse sociologique des organisations dans L’acteur et le système (Seuil, 1977).
Plus récemment, dans Le pouvoir et la règle (Seuil, 1993), Erhard Friedberg précise, en les prolongeant, les analyses entreprises dans le livre précédent.
Interview:
Pouvez-vous retracer les étapes de la constitution de la sociologie des organisations à la française.
Bien sûr. Pour ce faire, je commencerai par Le phénomène bureaucratique de Michel Crozier. Si vous reprenez ce livre, vous avez une première partie qui décrit une entreprise administrative, une deuxième partie qui décrit une industrie, une troisième partie qui est une interprétation en terme de dynamique organisationnelle de ce que les descriptions de deux cas ont fait apparaître, et finalement une quatrième partie qui essaie d’expliquer ces dynamiques organisationnelles comme étant le produit de la culture française. Expliquer est un mot peut-être un peu fort, Michel Crozier disant qu’il cherche des “harmoniques”…
Michel Crozier insiste beaucoup dans cette interprétation sur les relations de pouvoir comme étant constitutives de l’organisation (la notion de pouvoir n’est pas prise dans le sens de rapports de domination, mais de rapport d’échange). Par ailleurs, contrairement à la plupart des explications – depuis notamment celles du grand sociologue allemand Max Wéber –, il opère un renversement, en disant in fine: “la bureaucratie n’est pas une pathologie de quelque chose de rationnel, c’est un système qui a sa propre rationalité, et de plus c’est le produit des interactions entre les acteurs et de leurs capacités à organiser leur coopération”. Dans ses travaux, Gouldner avait opéré le même renversement.
Ce livre est aussi le point de départ d’une phase de recherche empirique qui coïncide avec la construction d’un centre d’étude des organisations qui deviendra plus tard le CSO, et avec la constitution d’une équipe se formant autour de Michel Crozier. Dès la deuxième moitié des années soixante, une série d’études sur les processus de changement dans l’administration française et les rapports de cette dernière avec la société est entreprise.
Enfin, Le phénomène bureaucratique est, dans sa quatrième et dernière partie, une interprétation, une explication de type culturaliste.
Vous semblez vous être éloignés de cette approche “culturaliste”, en ne mettant plus en fait moins l’accent sur l’importance du poids des cultures nationales dans votre approche?…
En effet. L’acteur et le système est, si vous voulez, la prise de distance de ce type d’interprétation. Le paradoxe, notons-le en passant, c’est que c’est cette dimension du phénomène bureaucratique qui a été responsable d’une bonne partie du succès du livre, notamment aux États-Unis: en quelque sorte, pour les américains, “ça racontait des choses sur les français.”
Quels travaux empiriques ont-ils été accomplis au cours du programme de recherche?
Il y a eu le travail de Pierre Grémion et de Jean-Pierre Worms sur les institutions régionales, celui de Catherine Grémion sur les processus de décision, celui de Jean-Claude Thoenig et de moi-même sur le Ministère de l’équipement, mon travail sur la politique industrielle, sans compter entre autres travaux ceux de Michel Crozier, notamment sur la planification. Autrement dit, le changement de l’administration française a été le premier vecteur pour élucider et développer le mode de raisonnement (la sociologie de Michel Crozier est connue sous le terme d'”analyse stratégique”) qui est contenu dans Le phénomène bureaucratique, lecture culturaliste mise à part.
Il semble y avoir eu un autre livre entre Le phénomène bureaucratique et L’acteur et le système…
Oui. À la charnière des années soixante et soixante-dix, une revue de formateurs a adressé à notre centre une commande nous demandant d’essayer de décrire de manière compréhensible notre manière de raisonner quand nous analysons des organisations. C’est donc à la suite de cette demande que j’ai écrite (personne d’autre au CSO ne voulant le faire) le petit livre publié en 1972 dans la revue “Pour”: L’analyse sociologique des organisations (Privat, 1972).
L’idée a été ensuite d’approfondir et de pousser jusqu’au bout cette réflexion des éléments d’un raisonnement. Cela a donné L’acteur et le système.
Dans ce livre vous étendez à l’analyse de la société les résultats des recherches que vous avez menées à partir d’organisations, … est-ce bien cela?
En fait, aucune des recherches que nous menions au CSO n’étaient des recherches portant sur une organisation à proprement parler. Il s’agissait d’administrations en rapport avec leur environnement, en rapport avec la société. Il s’agissait d’étudier des processus de décision, des processus d’élaboration de politiques, etc. Donc, l’idée consistait toujours en fait d’essayer de reconstruire des systèmes d’acteurs, vastes, dans lesquels l’organisation joue un rôle, mais qui ne sont pas eux-mêmes des organisations formalisées.
Dans ce livre, nous essayions donc de comprendre les régularités derrière les rapports existants entre un certain nombre de personnes qui étaient placées en interdépendance à travers l’élaboration d’une politique ou à travers la mise en oeuvre d’une politique, d’une décision, etc. Il faut bien dire que lorsque nous avons voulu expliciter ce raisonnement, on n’a pas tout de suite pensé à l’acteur et au système. Ce n’est qu’au cours de l’élaboration de notre travail qu’il est apparu clairement que notre raisonnement tournait autour de l’acteur et du système. D’où le titre.
Nous nous disions qu’il n’y avait pas de raison de limiter le raisonnement que nous élaborions à travers l’analyse des organisations, et que nous pouvions fort bien le transposer, l’appliquer à l’analyse des phénomènes d’actions collectives au sens le plus large. D’où le sous-titre du livre: les contraintes de l’action collective. En fait, les recherches empiriques menées au CSO ne portaient pas sur des organisations au sens strict, mais sur des choses beaucoup plus vagues. C’est pourquoi nous avons de plus en plus mis l’accent sur une problématique permettant de comprendre l’action collective.
Quel est l’apport de L’acteur et le système d’un point de vue de la théorie sociologique?
L’apport le plus fondamental – c’est quelque chose qui commence à être beaucoup plus admis aujourd’hui, mais qui au moment où on le livre est sorti ne l’était absolument pas –, c’est le dépassement de l’opposition entre une vision qui cherche à comprendre la réalité par l’acteur, et une autre qui part du système. Notre proposition vise à dire qu’il s’agit là de deux perspectives complémentaires qu’il faut articuler, l’articulation s’effectuant à travers le concept de jeu.
Cette articulation semble possible parce que vous ne vous appuyez pas – comme d’autres sociologues qui utilisent un cadre d’analyse marxiste – sur l’histoire…
Voilà. Notre sociologie aboutit très nécessairement à la notion de “contingence”: contingence réciproque de l’acteur et du système. Ce sont des systèmes qui sont à la fois contingents, au sens où ils dépendent d’un contexte, mais en même temps, ils sont contingents au sens philosophique du terme, c’est-à-dire qu’ils ne sont pas explicables, totalement par des déterminismes et des dépendances, car ils correspondent aussi à de la création.
N’y-a-t-il pas un autre sens du mot contingence?
Il y a une vision plate de la contingence qui est simplement dépendance ou adaptation.
Il y a une autre racine tout de même dans cette sociologie: il y a un brin d’existentialisme! La notion de contingence chez Sartre équivaut à “création à partir d’une liberté”.
Quand vous disiez que les “recherches” ne portaient pas uniquement sur des organisations au sens strict, mais sur des choses beaucoup plus “vagues”, qu’entendiez-vous par là?
Nous avions bien sûr travaillé sur des organisations au sens strict, une entreprise ou un groupe d’entreprises – et notre approche y est tout aussi opératoire –, mais, comme je vous l’ai dit, l’essentiel de nos travaux dans une première période portait sur des sujets tels que “le préfet et ses notables”, “la réforme d’institutions régionales”, etc., toutes ces études permettant de comprendre des “systèmes d’acteurs” qui dépassent les limites strictes d’une organisation. C’est en quelque sorte ce qui constitue le thème de mon dernier livre Le pouvoir et la règle; j’y montre qu’on a tort d’opposer les organisations à des contextes d’action plus flous.
L’idée, c’est toujours de montrer que l’on peut raisonner sur l’organisation, non pas comme entité finie, mais comme un processus de mise en ordre et de stabilisation d’interactions. Et il est intéressant de s’intéresser à ce deuxième sens, à cette deuxième signification du mot “organisation”, à la dynamique qu’elle contient. Dit autrement, il est plus intéressant de développer un raisonnement qui permette de comprendre, et les organisations, objets apparemment constitués, et les processus d’organisation dans des champs apparemment non-structurés. C’est tout le propos du livre Le pouvoir et la règle. Cette manière de voir permet d’éviter de bâtir une compréhension de la réalité sociale sur une fausse dichotomie: d’un côté il y aurait les organisations, et de l’autre, le reste.
Relativement au thème du pouvoir, quelle est l’évolution entre L’acteur et le système et Le pouvoir et la règle?
Dans Le pouvoir et la règle, ce que je travaille plus avant c’est toute la partie que j’appelle la dimension “collusive” du pouvoir, et non pas seulement “conflictuelle”. La dimension collusive, c’est-à-dire la complicité dans laquelle sont des gens qui sont en relation de pouvoir les uns avec les autres, et donc le côté structurant de la relation de pouvoir, dans la mesure où elle crée des règles. Un “système de pouvoir” et système d’échange et vice versa. Ce qui s’échange, ce sont des comportements, denrée incertaine par excellence. D’où l’irruption du pouvoir et de l’échange politique, notion que je travaille plus particulièrement dans Le pouvoir et la règle.
Dans votre dernier livre, la notion d’échange est prégnante et l’on a l’impression que tout est “marché”.
Le fonctionnement d’une organisation peut se comprendre comme la constitution d’un marché très règlementé dans lequel subsiste de la concurrence, autour des échanges des comportements pertinents pour la résolution des problèmes qui se posent à l’entreprise. Et ce n’est pas parce que vous avez créé un service de qualité, un service de méthode, un service de maintenance, que les problèmes quotidiens du montage sont toujours réglés selon les canaux de la structure formelle.