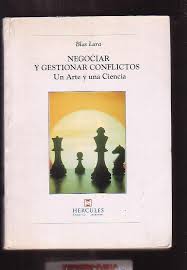Interview de Blaise Lara paru dans le Journal de Genève et Gazette de Lausanne, supplément hebdomadaire “Le Jeudi économique” en 1995.
Perspective:
Blaise Lara est professeur à l’École des HEC de l’Université de Lausanne. Il y enseigne la “statistique multivariée” (analyse des données) et la “recherche opérationnelle” (ou management science). Dans sa thèse de doctorat portant sur les limites de l’intelligence artificielle (The Boundaries of Machine Intelligence, 1965), il soutenait qu’il ne fallait pas mettre des espoirs inconsidérés – comme cela est encore le cas chez de nombreux auteurs – dans la possibilité des machines ou des mécanismes mathématiques à remplacer les capacités intellectuelles humaines. Pratique, son propos est d’évaluer comment mieux se servir des techniques – informatiques notamment – afin de palier les limites de la rationalité humaine: pour l’élargir et non y suppléer.
Parmi les écrits de Lara, on remarquera trois livres importants (non encore traduits en français), le premier traitant de la décision (La decision, un problema contemporaneo, 1990), le second de la négociation (La negociacion, un arte y una cienca, 1991), le troisième traitant du système judiciaire (El futuro del systema judicial, 1992). La caractéristique de ces ouvrages consiste à considérer la pratique sous un éclairage théorique, sans pour autant sacrifier à une approche authentiquement scientifique. Au point de départ de ses travaux, Blaise Lara emprunte une perspective neuro-physiologique, celle-ci permettant une tentative d’explication du comportement individuel, notamment en rapport avec la décision. Dans ce dernier domaine, il a notamment consacré une étude à la pathologie des décideurs.
Interview:
Le thème de la négociation semble être l’aspect central de vos cours. Pourquoi cet intérêt?
L’aspect central? Non, je ne pense pas. Mais assurément l’un des aspects importants. Je m’intéresse et j’essaie d’intéresser les étudiants à la problématique et à la pratique de la décision, etc. Et plus généralement j’essaie de les amener à un regard multidisciplinaire, disons transfacultaire, sur l’ensemble des questions économiques que nous étudions en cours.
Le but explicite de mon enseignement est d’entraîner les étudiants dans une démarche qui leur permette de mieux comprendre l’homme et de mieux comprendre le monde. À cet égard, franchement, ce qui me paraît fascinant –parfois tragique, risible, parfois problématique ou exaltant – est l’aventure de notre existence sur terre en tant qu’individus concrets, et plus précisément d’hommes et de femmes de cette fin de XXè siècle.
Je pense ainsi sans doute parce que je porte en moi la marque de ma génération. Ma génération a intensément imaginé, cherché, pensé et souhaité une transformation de la société. L’axiome de base était que pour la première fois dans l’histoire des hommes il nous avait été donné la capacité de remodeler le monde dans lequel on allait vivre. (Il me semble que cette formulation appartient à Teilhard de Chardin). Moi, comme tant d’autres, pensions que le savoir rationnel, une ingénierie du social – en d’autres mots, la science de l’action –, était en mesure de nous aider à construire le monde juste et efficace dont nous rêvions. C’était notre alternative à nous, une alternative rationnelle et non violente, face aux mouvements généreux mais souvent sanglants des hommes et femmes révolutionnaires qui ont vécu à notre époque. (On était déjà plus proches du sous-commandant Marcos que de Che Guevara!). Cette ambition de nature intellectuelle, mais de racine éthique, était fondée sur la foi non critique en la puissance d’un appareil méthodologique ou technique dont on a vu par la suite toutes les faiblesses. Et voilà que nous allions découvrir que notre projet de rationalisation de la décision politique était à son tour une utopie, pire encore, une erreur épistémologique. Un petit exemple pour être un peu plus clair: en matière de planification nationale, le Gosplan soviétique semblait être un matériau de rêve pour y greffer la mathématique des choix optimaux. Impossible! Le modèle comportait pas moins d’une cinquantaine de millions d’activités, et en plus nécessitait un rafraîchissement permanent des données. Mission mathématiquement impossible… du moins avec les instruments mathématiques de notre temps. Cela peut changer.
C’est donc le mélancolique retour de Don Quichotte après sa lutte chimérique contre les moulins à vents?
Ah non. Ici on ne se rend jamais! Après le constat d’écroulement de l’utopie rationnelle, je me sens de plus en plus proche des idées de l’économiste Friedrich Von Hayek et du physicien Michael Polanyi (tous deux étaient également des philosophes). C’est sûr que je ne crois plus à une transformation top-down imposée par la politique ou par la technologie sociale. Mon intérêt actuel porte sur les structures émergentes de la base, grâce auxquelles nos sociétés sont capables de produire des réponses adaptatives aux évolutions de l’environnement.
Un exemple de structures émergentes dans le social? Les nouveaux mouvements associatifs. Ce n’est que par des processus d’adaptation continues issues de la base que l’on peut aller vers une amélioration de la société. À une condition pourtant: que l’on ait dispersé dans le milieu social une sorte d’humus éthique, c’est-à-dire un bouillonnement de valeurs et des croyances (les “needs, beliefs and values” du sociologue américain Parsons) qui rend possible l’apparition de ces nouvelles structures.
Ces structures qui jaillissent par-ci et par-là de manière spontanée sont des produits de l’action plus que de la raison planifiante. Dès lors, elles posent des problèmes de compatibilité et, de ce fait, elles constituent un terrain propice à la collision d’intérêts entre individus et entre groupes. D’ailleurs, nous allons clairement vers un monde dans lequel les interactions entre cultures différentes iront en se multipliant. D’où le besoin de réfléchir à la naissance du conflit et aux processus de résolution du conflit. C’est dans cette optique que la négociation prend son sens. Même si nous descendons au niveau individuel, la négociation est notre lot quotidien à tous. L’homme est un animal prédateur qui se lève chaque matin de son lit – sa tanière – pour aller à la chasse des sensations, des émotions, du pouvoir, de l’argent… en concurrence avec ses semblables.
La négociation comme forme de civilisation par excellence…
Tout à fait. Une société qui résout ses conflits par la négociation est sans nul doute supérieure à celle de l’homme primitif qui résout tout à coup de massue, d’épée, de canon… ou de gueule! La négociation est évidemment la forme supérieure de régulation des interactions sociales, et elle sert à distinguer les sociétés culturellement mûres. Cependant, à l’échelle de l’individu, c’est une méthode qui peut être pervertie à l’avantage propre. La négociation s’étend à toutes les relations humaines, aux relations commerciales bien sûr, mais également au commerce entre les personnes, l’amour, les relations parents et enfants, l’amitié… tout cela relève de l’art de négocier, qui est l’art de mieux vivre. C’est pour cela que je pense qu’il est utile que la réflexion sur la négociation occupe une large plus importante dans le cursus de l’Université où l’on risque d’enseigner tant de choses inutiles.
Que pensez-vous donc de la théorie des jeux, qui a été la lauréate du Nobel d’économie de cette année?
L’attribution du Nobel souligne l’importance et l’énorme actualité du thème. Pourtant la théorie des jeux ne s’occupe que des aspects mathématiques et formels des interactions. Dites-moi, connaissez-vous l’algorithme qui vous assure le succès dans la conquête amoureuse?… Je suis revenu de ma foi ancienne dans la ferraille mathématique. La vie réelle est aussi et surtout de la chair autour du squelette. Elle est avant tout passion, pulsion.
Le mathématicien pur serait plutôt le pigeon sur lequel tout le monde tire. Un théorème d’équilibre de la théorie des jeux ne lui fera perdre ni son innocence ni sa naïveté dans le jeu de la vie. En d’autres termes, la mathématique demeure hautaine et distante du jeu social de dominants et dominés, dans lequel l’inavouable constitue souvent l’élément déterminant du succès et non pas ce qui est formalisable…
Quelle rationalité peut-on chercher lorsque l’homme ne sait pas souvent ce qu’il veut, cherche ce qui ne lui convient pas, se laisse entraîner dans les lubies du moment? C’est ainsi que l’être humain est fait. Peut-être avez-vous entendu parler de l’état central fluctuant de notre cerveau dont parle Jean-Didier Vincent, ou de la chaudière prête à l’explosion qu’est notre système limbique, au centre même du cerveau?
À propos. J’ai cru comprendre à la lecture de vos livres que pour vous une des réponses aux problèmes de notre époque passe par une meilleure connaissance du cerveau.
Effectivement. Ce n’est pas ma spécialité officielle, mais depuis une bonne vingtaine d’années je lis goulûment toute publication sérieuse relative au cerveau qui tombe sous mes yeux. Je suis absolument convaincu du rôle de carrefour du savoir du XXIè siècle que va occuper la neuro-physiologie.
La connaissance du fonctionnement du système nerveux central, malgré ses trous, malgré son caractère fragmentaire, aide énormément à comprendre une variété de problèmes tels que les comportements pathologiques des négociateurs, le choix d’attitudes stratégiques ou des styles personnels de négociation, etc. Même si avec les connaissances actuelles on est loin de la maîtrise des problèmes, quel plaisir de découvrir la cohérence des fragments de savoir! Mais je vous propose de quitter un sujet qu’on ne peut pas traiter à la sauvette. Si vous avez encore une question…
On sent chez vous une vocation. Vous êtes un enseignant dans l’âme. L’Université répond-elle aux besoins de l’extérieur? Doit-elle répondre à ces besoins, voire fournir un “produit” répondant aux critères des entreprises?
C’est une très importante question. D’une part, il ne faut pas convertir l’Université en une machine à fournir des employés à l’économie. Si elle ne servait qu’à combler les trous des places vacantes chaque année, cela entraînerait pour elle une subordination inacceptable. Et pourtant il faut que l’étudiant trouve du travail à la fin de ses études. C’est le point critique. Parce que la formation actuelle ne prépare pas pour des places spécifiques – elle ne le peut pas –, elle se dirige dans toutes les directions. C’est comme si, au bout de trois ou quatre ans d’études, on exigeait d’un étudiant en médecine d’être capable aussi bien d’arracher des dents que de faire de la chirurgie cardiaque ou de la pédiatrie. Il ne saurait pas. Qui donc peut penser que les licenciés HEC pourraient être immédiatement opérationnels dans l’assurance, l’industrie chimique, la banque…? Ne faudrait-il pas se cantonner à des principes profondément et solidement acquis? Acquérir ce que l’entreprise ne peut pas nous donner par simple osmose, par le seul fait de remplir une chaise dans un bureau? L’Uni doit donner ce qui fera le label de qualité du futur manager.
Bien que, tout compte fait, je pense qu’il faut aussi fournir des “ronds-de-cuir”, des cadres moyens, pour le système fonctionne. Par rapport à ses besoins, la société n’exige pas de personnes trop intelligentes. Au contraire, l’establishment a besoin de broyer de l’insignifiance, puisqu’il s’alimente de la médiocrité. Cela lui assure une certaine stabilité et lui permet de ne pas éclater.
Voulez-vous dire qu’idéalement il faudrait alors former des marginaux?
L’excellence ne serait-elle pas marginale? La société ne peut pas être constituée de tels gens marginaux car si chacun avait la capacité et l’envie de reconstruire le monde, s’il n’y avait que des Lénine, des Marx, des Gandhi, ou bien d’autres, cela ferait un sacré pétard.
Quel serait donc le meilleur savoir pour un économiste d’entreprise?
Il lui faut avant tout une docte ignorance. C’est une expression que j’emprunte à Nicolas de Cues. Une docte ignorance qui permettrait à l’homme universitaire de se situer dans les coordonnées idéologiques de son temps, d’être conscient des chemins dans lesquels se déploie la pensée contemporaine. Cette docte ignorance engloberait des connaissances relevant de la sociologie, de la philosophie ainsi que d’autres disciplines anthropologiques. J’ajoute qu’une introduction à la sémantique de ces disciplines devrait suffire. C’est déjà beaucoup!