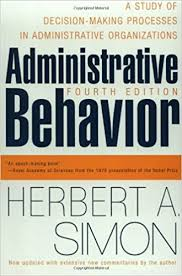Interview d’Herbert Simon mené avec Vincent Calvez, paru dans la revue Gérer et comprendre en 1998.
Perspective:
Abondamment cité pour ses travaux relatifs au processus de prise de décision à l’intérieur des organisations, Herbert A. Simon – lauréat du prix Nobel de sciences économiques en 1978 pour ses travaux portant sur la rationalité – est un auteur difficilement classable. Ses apports sont, en effet, reconnus dans de nombreux domaines: psychologie, science politique, mathématiques appliquées, sciences économiques (1). Il est, en outre, un des pères de l’intelligence artificielle. Herbert Simon a critiqué le postulat de rationalité économique, dit de l’”homo œconomicus” et l’idée d’optimisation que ledit postulat induit. Prenant en compte les limites cognitives inhérentes à la psychologie humaine, il a proposé un principe de rationalité connu en français sous le nom de “rationalité limitée”, traduction française de “bounded rationality”; nous préférons quant à nous la traduction suivante: “rationalité liée”.
Deux de ses ouvrages traduits en français constituent des références incontournables dans le domaine de la théorie des organisations et du management: Administration et processus de décision [Economica] – version française de Administrative Behavior – et Les organisations [écrit avec J. March; Dunod].
Interview:
Votre livre Administrative behavior [1947] est l’un de ceux qui ont le plus marqué les théories du management. Pourriez-vous retracer la relation entre votre ouvrage et les deux autres ouvrages fondateurs suivants: The functions of the executive, de Chester Barnard et A behavioral theory of the firm, de Richard M. Cyert et James G. March?
J’avais beaucoup lu l’ouvrage de Barnard, peu de temps après sa parution. En ce temps-là, j’étais en train d’écrire un manuel sur l’administration municipale et j’avais trouvé le livre de Barnard très intéressant, très réfléchi. Il prenait un point de vue très attirant car il mettait la prise de décision au centre des choses et, personnellement, ça me semblait très important. Cet ouvrage a eu une influence certaine sur Administrative behavior que j’ai commencé à écrire deux ans après. Comme vous le savez, j’ai dû citer Barnard en bas de page une vingtaine de fois dans cet ouvrage, ce qui illustre son influence particulière. Il m’a amené à tenir compte du processus de décision comme d’une sorte de phénomène central dans l’administration, ce que je n’aurais pas fait ou n’aurais pas été capable de faire si je n’avais pas été familiarisé avec son ouvrage.
Quelques années plus tard, vers la fin des années quarante ou le début des années cinquante, lorsque je suis venu à l’Université Carnegie Mellon, je me suis activement engagé, au sein d’un petit groupe, dans des études empiriques sur les organisations, en essayant de sortir de l’université afin d’étudier le processus de prise de décision dans les entreprises. J.G. March et R.M. Cyert faisaient partie de ce groupe et travaillaient ensemble à ce qui deviendrait plus tard leur livre Behavioral theory of the firm. Il y a ainsi une relation historique très proche entre ces trois ouvrages.
Quelles sont les différences entre ces livres?
Barnard parlait de management à partir de sa grande expérience des entreprises, tant publiques que privées. De mon côté, j’essayais d’établir un rapport entre le processus de décision et ce que je connaissais de la psychologie humaine et de construire autour de tout çà une image de l’organisation. Mon approche était donc, je le suppose, un peu plus systématique, un peu plus théoriquement orientée.
Pouvons-nous maintenant passer aux questions relatives à votre concept de rationalité? Une de vos propositions les plus connues a trait à la “rationalité limitée”, que vous avez appelée “procedural rationality” ou encore “bounded rationality”. Pouvez-vous préciser?
En anglais, j’utilise l’expression “bounded rationality”, qui a parfois été traduite en français par “rationalité limitée”. Mais, en général, je n’utilise pas ce terme de “limité”. Si je l’ai utilisé, c’était pour signifier la même chose que rationalité “bornée”, c’est-à-dire que la notion d’optimisation est, bien évidemment, tout simplement impossible pour nous, humains, à cause des limites de nos capacités cognitives, des limites de nos connaissances et de toutes nos autres limites. Si l’on retient ce point de vue, il devient alors important d’étudier, non seulement de quoi les décisions sont faites, mais également le processus qui sert à les prendre, car c’est dans ces processus que vous trouvez les limites cognitives humaines. Mon intérêt se porte donc sur la rationalité “bornée”, sur l’étude empirique du processus cognitif, du “comment” les gens prennent les décisions et non, simplement, sur l’élaboration de théories hypothétiques. Après avoir écrit Administrative Behaviour, je me suis ensuite engagé dans l’étude, toujours d’une manière empirique, de la question suivante: “Est-ce que ce cadre d’analyse décrit, ou non, les organisations et leur fonctionnement? “. Je venais d’arriver à Pittsburgh, dans une nouvelle “business school” et, pour réaliser cette nouvelle étude, il me fallait aller sur le terrain et observer le processus de décision dans des entreprises. J’ai commencé par participer à une importante étude sur l’utilisation de l’information comptable dans cinq ou six sociétés. Durant cette étude, je me suis intéressé aux tout nouveaux ordinateurs et j’ai fait le rapprochement entre la manière dont les humains pensent et les théories et processus internes qui président au fonctionnement d’un ordinateur. Sur la base de cette analogie, j’ai commencé à penser, de plus en plus, en termes d’”information processing”. En fait, ce n’était qu’une autre façon de parler de la décision mais, désormais, j’avais une idée plus claire et plus précise de la forme qu’une éventuelle théorie pourrait prendre. Je me suis alors, et de plus en plus, impliqué dans l’étude des processus de décision, en observant non seulement les comportements humains, mais aussi l’écriture des programmes d’ordinateurs destinés à résoudre des problèmes, à prendre des décisions et à simuler les processus humains.
Pensez-vous qu’une machine puisse penser comme un être humain?
Les machines pensent depuis – à peu près – 1955, si par “penser”, vous signifiez “accomplir des tâches qui, si elles étaient accomplies par une personne, donneraient l’évidence que la personne pense en les exécutant” et si vous signifiez également “utiliser des processus semblables aux processus cognitifs humains”. Aujourd’hui, il y a une énorme quantité de données empiriques issues de cas où l’on a pu, avec succès, simuler de manière très fidèle les processus de la pensée humaine opérant dans des tâches difficiles. Il y a d’ailleurs, aujourd’hui, des programmes d’ordinateur qui établissent des diagnostics médicaux d’une manière très proche de celle des humains.
Professeur Simon, vous êtes économiste, mais vous avez critiqué les bases mêmes de l’économie néo-classique. Qu’est-ce à dire?
La théorie néoclassique repose sur le postulat de la rationalité économique, à savoir qu’il n’y a pas de bornes, que les personnes peuvent voir la situation dans laquelle elles sont, qu’elles connaissent toutes les alternatives, toutes les conséquences des alternatives ou, au minimum, leur distribution de probabilités et qu’elles sont assez astucieuses pour prendre la décision optimale. Je pense que c’est une caricature du monde dans lequel nous vivons: si nous devons dire quelque chose de vrai à propos du monde économique, nous devons reconnaître, d’abord, les limites de la pensée humaine, puis examiner de façon empirique les faits réels. Cette prise de position nous éloigne assurément de la théorie néo-classique.
Vous avez écrit qu’il est possible de faire de l’économie autrement qu’”assis dans un fauteuil”. Quel type de méthode de recherche préconisez-vous?
En effet, j’ai mis l’accent sur l’étude des phénomènes tels qu’ils sont et non, en les imaginant, assis dans son fauteuil, tels qu’ils pourraient être. À ma connaissance – et aussi étrange que cela puisse paraître – l’économie est la seule discipline où l’on fasse aussi peu appel aux faits concrets. Quant aux méthodes de recherche, je ne pense pas qu’il n’y en ait qu’une: tout dépend d’où et comment vous trouvez les faits. Lorsqu’on utilise des méthodes quantitatives, telle l’économétrie, on raisonne sur des données agrégées, sans jamais entrer dans le détail. C’est pourquoi de plus en plus d’économistes empruntent aujourd’hui des voies plus expérimentales, en étudiant les règles spécifiques à certains marchés, par exemple. Parfois ils vont un peu plus loin, en mettant en relation la façon dont les agents agissent avec des programmes informatiques qui permettent d’analyser les différentes stratégies retenues. Il y a toutefois une troisième façon de faire de l’économie: d’une manière plus empirique, en mettant l’accent sur l’observation concrète des processus de décision. C’est la voie que je préconise.
Dans quelle mesure pensez-vous que l’utilisation de méthodes dites “compréhensives”, qui font peu appel à la modélisation comme, par exemple, la méthode ethnographique, puisse contribuer à une meilleure compréhension des organisations?
Aller sur le terrain pour y effectuer des études descriptives est une bonne façon de procéder, quel que soit le champ disciplinaire. Les travaux ethnographiques me semblent donc très utiles. Néanmoins, les attitudes courantes en ethnologie débouchent toujours sur un relativisme culturel. Les ethnographes s’emploient à décrire des faits culturels. L’ethnologie contemporaine a, à mon avis, exagéré ce relativisme culturel. Ma position philosophique personnelle revient à dire qu’il existe une réalité hors de nous et que la question consiste à comprendre comment les personnes s’y prennent avec elle. Les différences culturelles ne sont, de mon point de vue, qu’une partie de la réalité.
Vous vous êtes toujours attaché à bien séparer les “faits” et les “valeurs”. Est-ce à dire qu’un scientifique ne doit en aucun cas porter de jugement de valeur?
Un scientifique peut émettre des jugements de valeur, mais cela signifie que la justification de ces jugements ne peut être faite de façon purement objective à partir de faits du terrain. Si un scientifique porte un jugement de valeur concernant, par exemple, l’environnement, il ne dit pas seulement que telles ou telles actions vont être dommageables pour cet environnement, mais que celui-ci doit être préservé, ce qui implique quelque chose de plus à quoi la science ne peut répondre, car ce type de positionnement enchâsse un système de valeurs et implique un objectif. Afin de comprendre pourquoi, par exemple, l’environnement doit être préservé, vous devez avoir un but, un ensemble de valeurs. Quelqu’un d’autre peut avoir des buts différents et, cependant, nous pouvons ensemble argumenter scientifiquement. Nous en arrivons à un point où nous avons juste à dire: “Bien, voilà, ce sont mes valeurs”.
Donc, quel est votre point de vue?
Une fois les valeurs mises au jour, il est possible d’aborder de façon scientifique les effets de mesures particulières. Il faut prendre en compte le fait que la science n’est pas une solution universelle à tous les problèmes. Nous devons l’accepter.
Pour prendre un exemple concret, les vagues de “downsizing” et de “reengineering” semblent avoir mis à mal la légitimité de ces institutions particulières que sont les entreprises. Avez-vous une opinion sur ce type de question?
Votre question comporte deux aspects. Il est vrai que l’on a assisté à des vagues de “downsizing” et de “reengineering” ces dernières années. Certains diront que ces actions ne sont, après tout, que des effets d’un bon management dans une situation de vive compétition, à savoir: évaluer si, dans vos opérations de production, vous avez des frais que vous ne devriez pas avoir. Cette position logique est défendable. Toute autre chose est de savoir vraiment ce que ces opérations occasionnent! Elles peuvent conduire à sacrifier le long terme au profit du court terme et en mesurer les conséquences prendra des années! Je pense, par exemple, aux effets du “downsizing” sur les départements de Recherche et Développement. Maintenant, l’autre question est, bien sûr, de savoir comment on ressent ces phénomènes d’un point de vue social et s’il ne s’agit pas d’une concentration des profits dans les mains de quelques-uns au détriment du plus grand nombre. Je crois personnellement, et ce sont là mes valeurs (je ne réponds pas uniquement comme un scientifique), que nous sommes encore assez frileux au sujet des besoins des gens dans notre société, du besoin d’apporter du changement social et du besoin d’apporter une productivité de telle manière que le coût ne soit pas supporté uniquement par des individus mais en laissant la société assumer ce coût. Le problème – ou la solution – n’est pas de gérer des entreprises inefficaces, mais de conduire une société dans laquelle le gouvernement doit avoir des responsabilités et l’intelligence de maintenir un plein emploi et un régime fiscal susceptible d’assurer une redistribution raisonnable des gains de productivité dans la société. Mais, maintenant, comment le faire? Vous conviendrez que cette question demanderait tout de même de plus amples développements, et que cela pourrait nous amener bien loin dans notre discussion.
Pouvez-vous préciser comment s’est construite la notion de “contrat organisationnel”?[1]
Cela m’est venu en pensant la théorie de la firme en termes organisationnels. La théorie de la firme, en ce temps-là (nous parlons des années 50), ne faisait pas vraiment de distinction entre un contrat d’embauche et n’importe quel autre type de contrat. Or, il y a des différences fondamentales. Lorsque vous établissez un contrat avec un plombier, c’est pour réparer l’évier de votre cuisine. Si vous passez un contrat pour acheter une voiture, c’est encore particulier: cela concerne un produit spécifique que vous obtenez en échange d’un certain montant d’argent. Si vous signez un contrat d’embauche, par contre, ce que vous échangez contre le salaire que vous recevrez, c’est l’acceptation du pouvoir qu’a votre employeur de décider comment vous allez passer vos journées. À l’intérieur de certaines limites, bien sûr! Il ne peut vous demander de sauter à l’élastique du haut d’un building ou des choses de la sorte. Il vous demande de faire “Je me suis impliqué dans l’étude des processus de décision en observant, non seulement les comportements humains, mais aussi l’écriture des programmes d’ordinateurs destinés à résoudre des problèmes, à prendre des décisions et à simuler les processus humains.” des choses qui sont à l’intérieur de vos possibilités. C’est donc un contrat très différent des positions défendues par la théorie de la firme. Plusieurs choses sont laissées à la décision de l’employeur, et c’est là ce qu’il achète réellement: la capacité d’utiliser vos compétences pour résoudre ses problèmes.
—
[1] Il s’agit également de relier cette notion à celles de “l’équilibre de l’organisation” que Simon [1947] reprend aussi de Barnard [1938]. March et Simon précisent d’ailleurs que la décision de participer se trouve au cœur de cette théorie de l’équilibre de l’organisation [Les Organisations, Dunod, 1995, p.38]. Autrement dit, si un certain équilibre organisationnel n’est pas atteint (entre, par exemple, les demandes de la direction et les rétributions offertes), les apports des employés (ceux qui dépassent la simple fiche de poste) s’en trouveront diminués.
—
Y a-t-il une dimension philosophique dans votre œuvre?
Cela dépend de ce qu’on entend par philosophie mais, oui, on peut évoquer plusieurs aspects philosophiques à propos de mon travail. Les plus évidents concernent la méthodologie. En fait, j’ai écrit un bon nombre de choses dans le domaine de la philosophie des sciences et beaucoup d’écrits ont des liens avec la “rationalité bornée”, car le type de philosophie avec laquelle je me sens bien tient compte des limitations du savoir et des capacités à calculer.
Pouvez-vous nous dire quelques mots à propos de vos liens avec Rudolf Carnap?
Pour les illustrer, voici une petite anecdote. Je pensais, à propos d’un point technique dans sa syntaxe logique du langage, qu’il était dans l’erreur. Je lui en ai fait part au cours d’une conversation, sans toutefois réussir à le convaincre. Pourtant, par la suite, j’ai remarqué dans son autobiographie qu’il avait changé de position, mais je ne sais pas si c’est au souvenir de cette conversation… C’était, toutefois, un point très spécifique. Plus généralement, et en ce qui concerne le positivisme, beaucoup de choses ont changé depuis Carnap et je ne sais pas si je suis moi-même un positiviste ou un empiriste. Actuellement, le mot “positiviste” a pris une signification très spéciale. Mais je pense que mes opinions et attitudes sont proches, sous plusieurs aspects, de celles de Carnap. Aussi, je me vois, sous l’angle philosophique, comme un étudiant de Carnap.
Herbert Simon et Rudolf Carnap
Dans son ouvrage autobiographique, Models of my life, Herbert Simon souligne l’importance que Rudolph Carnap a eu pour ses choix et pour son cheminement intellectuel. Membre du groupe de philosophes rassemblés sous le label de Cercle de Vienne, Carnap a immigré aux États-Unis – comme bon nombre de ses collègues – au début des années quarante. Pour ces penseurs, il n’y a de connaissance que tirée de l’expérience sur laquelle il convient d’appliquer la méthode de l’analyse logique du langage. En effet, il paraît indispensable aux philosophes du Cercle de Vienne, de n’avoir de cesse de clarifier les concepts des sciences particulières à l’aide de l’analyse logique. Comme Carnap, Simon avoue avoir toujours porté un grand intérêt à la logique des sciences sociales. D’ailleurs, avant de mettre l’accent dans sa thèse sur la prise de décision, qui deviendra le classique Administrative Behavior, il prévoyait d’étudier rien moins que les fondations logiques des sciences administratives. Homme d’une curiosité insatiable, passant alertement d’un sujet à l’autre, il a probablement abandonné son projet initial par manque d’un véritable mentor dans ce domaine. La relation qu’il a entretenue avec Carnap s’est en effet limitée à un échange épistolaire, engagé à la suite d’une conférence du maître. Faisant référence, dans son autobiographie, à l’ouvrage de Carnap, La syntaxe logique du langage (1934), Herbert Simon dit avoir pointé des difficultés dont il s’ouvrit à l’auteur. C’est, du reste, de cette interpellation qu’est née – à son sens – une révision par Carnap de ses propositions, confirmée dans une réimpression de l’ouvrage en question quelques années plus tard, voire même un changement de perspective du maître opéré dans un autre ouvrage majeur, subséquent: Introduction à la sémantique. Glissons sur des débats philosophiques par trop techniques, en mentionnant néanmoins que le point de départ de la réflexion des penseurs viennois se situe dans la distinction opérée par Kant entre jugements synthétiques et analytiques, et son invention du synthétique a priori, à laquelle s’opposent Carnap et ses collègues [pour une analyse très approfondie, voir l’ouvrage de Françoise Proust, Questions de forme, Fayard]. Retenons, quant à nous, la conception très positiviste de Simon qui considère que la découverte scientifique consiste à exprimer les données d’observation dans une forme synthétique, ni plus, ni moins. Conception éminemment réaliste aussi car, si la découverte scientifique est considérée comme justifiable du point théorique, elle est aussi vue comme une réalité. Dans le sillage des positivistes logiques, Simon semble réduire la philosophie à une activité visant à l’élucidation du sens et de la structure des énoncés. En cela, on comprend que Mintzberg, héritier d’une tradition philosophique autrement plus pragmatique, critique la position de Simon, soutenant qu’on ne peut analyser une organisation de la même façon qu’on le fait d’un langage [voir sa recension du livre de Simon, “The New Science of Management”, dans Administration Science Quarterly de juin 1977].